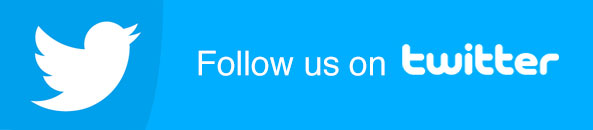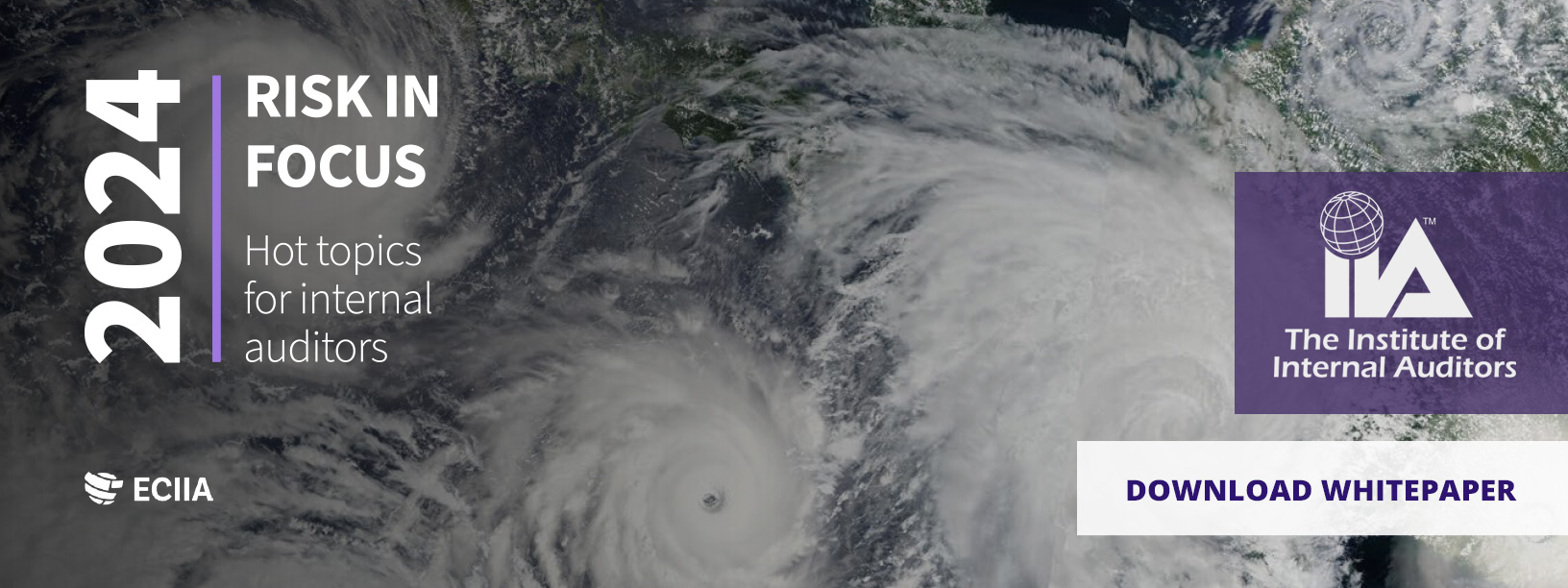Il faut réinstaurer les dispositions Monory-De Clercq
Sur l’échelle de Richter des bouleversements économiques, les années 2008-14 auront été celles du pire choc sismique en un siècle. La débâcle de Fortis et la recapitalisation précipitée de plusieurs institutions financières ont rappelé les risques inhérents à l’investissement boursier. La stabilité de la sphère bancaire en a été fort abîmée. Il peut paraître incongru de promouvoir l’investissement en actions après un krach, et l’idée doit certainement faire son chemin.
Depuis 30 ans, le capital à risque est l’orphelin du financement de l’économie belge. Au niveau macro-économique, les chiffres sont stupéfiants. Sur une période de 15 ans, moins de 5 % de l’épargne des particuliers s’est orientée vers l’investissement direct en actions. Cette précarisation du capital à risque est telle que les pouvoirs publics doivent eux-mêmes stimuler la capitalisation des entreprises.
Au niveau fiscal, la pénalisation du capital à risque est encore plus cinglante. Malgré le remarquable apport des intérêts notionnels, les dividendes restent fiscalement défavorisés par rapport aux intérêts des dettes. Le précompte mobilier est plus lourd pour les dividendes que pour les intérêts. Une fiscalité d’entreprenariat devrait taxer plus légèrement les actions que les placements sans risque. Or, au lieu de la stimuler, la fiscalité pénalise la prise de risque.
Pourquoi le Royaume a-t-il développé une telle défiance par rapport au capital à risque ? Intuitivement, notre pays aurait dû, comme le Grand-duché de Luxembourg, faire de la fiscalité un outil de compétitivité et d’attractivité économique. Il y eu, bien sûr, des raisons politiques, très prégnantes dans les années septante mais aujourd’hui anachroniques. L’instabilité juridique et la pusillanimité politique ont aussi certainement contribué à ce climat. L’État n’a pas rassuré les actionnaires.
A l’époque, les politiques de dépenses publiques entraînèrent le pays dans le gouffre des déficits et de l’endettement publics. Les pouvoirs publics n’eurent d’autre choix que de financer les creux budgétaires par un appel massif à l’emprunt. Le choix obligé fut donc de faire appel à l’épargne nationale, par des émissions d’emprunts à répétition. Le volume de ces derniers fut tel qu’il assécha le marché des capitaux au détriment des investissements productifs, c’est-à-dire du capital à risque. La bourse de Bruxelles fut d’ailleurs, au début des années quatre-vingt, totalement désertée.
Ce phénomène entraîna deux conséquences sérieuses. Tout d’abord, le taux d’intérêt des emprunts d’État belge dut être majoré d’une prime (afin de couvrir les risques de dépréciation du franc belge et le risque de solvabilité inhérent à l’État belge), au détriment global des pouvoirs publics. Ensuite, le rendement du capital à risque, déjà émoussé par les poussées inflationnistes et une fiscalité lourde, ne fut plus suffisamment attractif en comparaison des placements sans risque.
C’est la nécessité d’avantager fiscalement la souscription des emprunts d’État qui conduisit à pénaliser la fiscalité des revenus d’actions. Différentes mesures imaginées par le Sénateur Etienne Cooreman, comme les actions AFV et les souscriptions Monory-De Clercq, habilement mises en œuvre en 1982-3, pallièrent cette situation. Une bonification fiscale fut allouée aux nouvelles souscriptions d’actions dont la contrepartie devait être affectée à certains investissements productifs.
Près de 30 ans plus tard, des relais fiscaux doivent être envisagés. En effet, l’argent public injecté dans certaines bancaires et des plans de relance, ne sera jamais un relais naturel au capital à risque. Le temps est sans doute venu d’imaginer des solutions nouvelles. Nous irriguons le débat avec l’idée suivante : celle d’un système d’épargne-actions, complémentaire à l’épargne-pension. L’objectif serait d’investir à long terme dans des augmentations de capital, c’est-à-dire des nouveaux apports de capitaux à risque. Ces investissements se seraient effectués au travers de fonds, gérés par des banques et des compagnies d’assurances. Le système se rapprocherait des déductions Monory-De Clercq qui, à l’époque, étaient limitées à 1.000 euro par personne. La déductibilité fiscale conduirait à une réduction d’impôt de l’ordre de 30 % sur les sommes investies. Il s’agirait donc de promouvoir des apports de capitaux frais à des sociétés, avec les avantages de la diversification, de la liquidité assurée par la cotation des fonds et de la déductibilité fiscale.
Les fonds devraient être conservés pendant un nombre minimal d’années (5 à 10 ans) afin d’éviter la réalisation de gains à court terme. Le système n’aurait rien de révolutionnaire. Il existe, en France, sous le vocable « Plan d’épargne en actions » ou PEA. Il serait utile de s’en inspirer. En résumé, il est utile de tirer des leçons des traumatismes financiers de l’année 2008 et d’étançonner l’actionnariat. Sous cet éclairage, la mise sur place d’un système d’épargne-actions serait opportune.