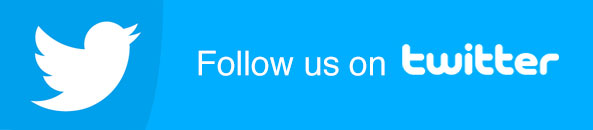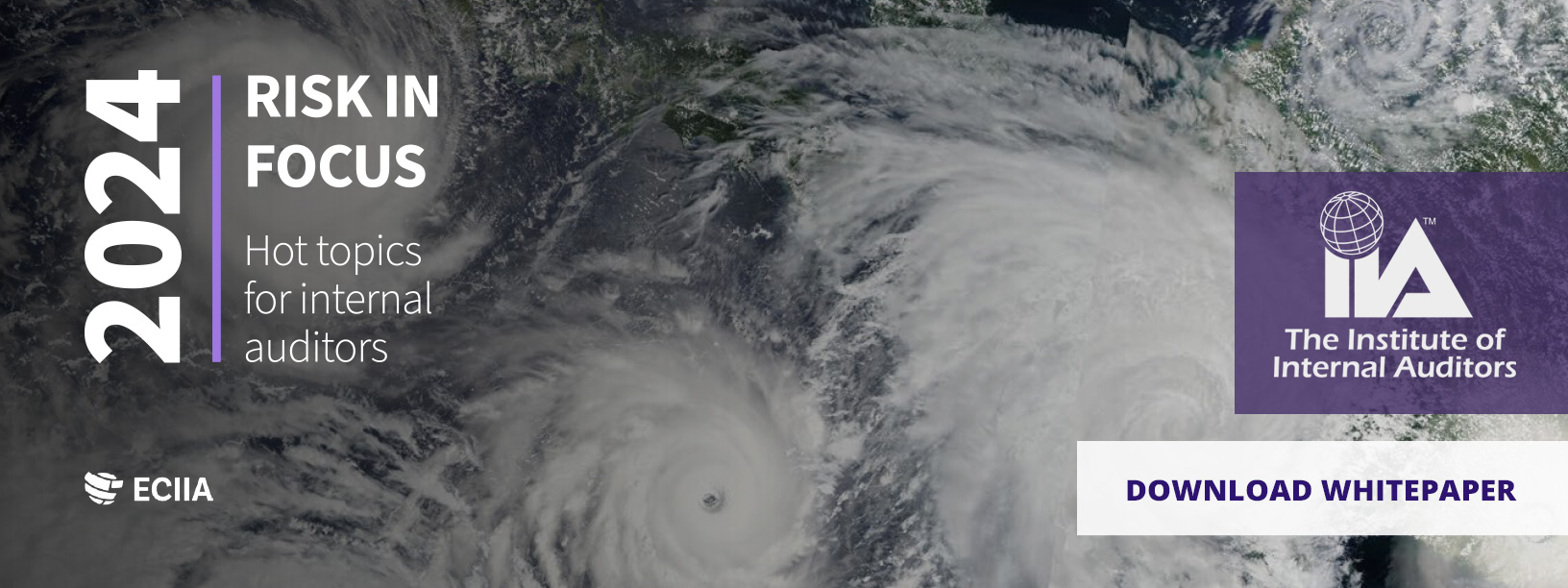Mon credo : il faut une révolution morale
Souvent, je m’interroge sur la trajectoire de nos communautés. Nos sociétés vieillissent mal. Pétries de certitudes géographiques et centrées sur un tropisme européen, elles ne réalisent pas que le monde s’est étendu dans les azimuts verticaux. Nous sommes imprégnés d’une suprématie civilisationnelle des années industrielles, mais la croissance s’est encourue. Et comme nous vieillissons, la jeunesse n’exerce pas suffisamment une saine et cette nécessaire force de rappel. La crise de 2008 fut un signe majeur : elle signifia la fin d’un monde de rentiers d’idées. Mais il y a autre chose. Pas un naufrage, mais plutôt une infime et inéluctable dérive. Une morosité silencieuse. Une résignation. De nombreux citoyens le ressentent, mais peu l’expriment. C’est un sentiment flou, teinté d’amertume des grandeurs passées et d’incompréhension des réalités modernes. Cette crise n’est qu’une expression accessoire. De profonds chocs socio-politiques sont proches parce que nous n’arriverons plus à assurer la cohésion et la mixité sociales. En effet, la croissance économique est une échappée dans le futur. Son absence devient une prison puisqu’il n’est pas possible de se projeter dans un avenir économique meilleur.
Quels sont les murs de cette geôle ? Il s’agit de la gigantesque soustraction des dettes que nous avons contractées et qui doivent être défalquées de notre futur, comme un monde qui se renverserait. Il s’agit, bien sûr, de la dette publique, mais aussi des autres dettes sociales, comme l’accentuation des inégalités, et des dettes sociétales dont les latences environnementales et climatologiques. Cette déduction du futur, qui ne peut plus s’opérer sur la croissance, pourrait conduire à l’exclusion et à la prédation, d’autant que la pénétration dans l’économie digitale va temporairement pulvériser des pans entiers de l’économie marchande.
Nos temps ne sont pas ceux d’une crise, mais d’un bouleversement structurel, d’autant qu’on ne peut plus dissocier les crépitements sociaux d’un modèle d’économie de marché qui n’est plus tempéré par l’Etat. C’est une rupture et une prise de conscience. Je veux dire une véritable prise de conscience, pas l’expression mondaine ou convenue de ceux qui disent que tout change en espérant que rien ne les affectera. C’est l’adieu au vingtième siècle. C’est l’abandon au monde de l’inertie, de la tétanie. Cette charnière qui grince avec le siècle qui s’est refermé, c’est aussi, malheureusement, l’oubli de tous les drames et totalitarismes qui l’ont assassiné deux fois.
Cette crise n’est donc plus souveraine, ni monétaire : elle porte sur l’exercice des États, écartelés entre des entreprises mondiales et versatiles, et des dettes publiques dont la stabilité de l’expression monétaire et le refinancement sont les garants de l’ordre social. Nos politiques sont étatico-nationales alors que le marché est mondial.
Dans les prochaines années, le débat idéologique portera sur le dialogue entre l’État et le marché, entre la collectivité et l’individu, et entre la dette publique et la propriété privée. Certains exigeront une étatisation croissante, voire généralisée, de l’économie, pour maintenir l’ordre social. D’autres argumenteront que cette voie conduirait à désertifier toute initiative spontanée. Les insoutenables dettes publiques engageront la question du défaut ou de l’opposition sociale.
La véritable question portera sur la représentation de l’avenir du corps social car les configurations sociales deviennent extrêmement vulnérables. Les démocraties seront mises à l’épreuve dans le sillage des chocs économiques. Insidieusement, d’autres configurations politiques, plus autoritaires, risquent d’émerger.
Notre siècle sera-t-il plus apaisant ? Je ne le crois pas. Tout se met en place pour alimenter les replis identitaires, les égoïsmes, les pertes de civilités dont certains espèrent sortir gagnants, alors que tous nous en sortirions perdants. À moins de vérifier que l’exclusion et l’ostracisme soient des choix démocratiques, et donc partagés, quelle société voulons-nous ? Une société d’ouverture, dans l’intelligence de la justice et de la sécurité ? Ou bien une société ostracisant qui fragmente les classes sociales, les attachements territoriaux, les affinités linguistiques et culturelles ?
Il faut résolument s’opposer à la fracturation de notre société. Pourtant, chaque jour, certains s’accommodent des outrances et des débordements verbaux. Pour ceux-là, la ligne rouge n’existe plus au motif de leur propre survie politique. Mais quelles valeurs morales veulent-ils formuler, au-delà d’une sombre mathématique électorale dont ils seront évidemment les victimes ?
Partout, en Europe et en Belgique, des rémanences des temps odieux sont rappelés. Mais savent-ils, tous ceux qui adhèrent en toute bonhommie à des idées répressives, que chaque homme commence l’humanité et que chaque homme la termine ? Savent-ils que la liberté et la tolérance sont des combats ? Savent-ils que, pendant des milliers d’années, des hommes ont relevé la tête plutôt que des fusils, des bras et des mentons ? Que des hommes ont préféré éteindre les combats plutôt que d’allumer les marches au flambeau ? Car, dans « La reine morte », le roi Ferrante dit « Et un jour, tout sera bouleversé par les mains hasardeuses du temps ».
Bruno Colmant