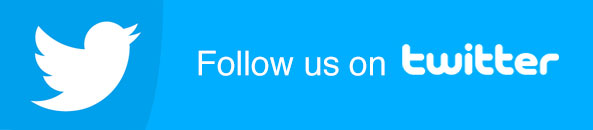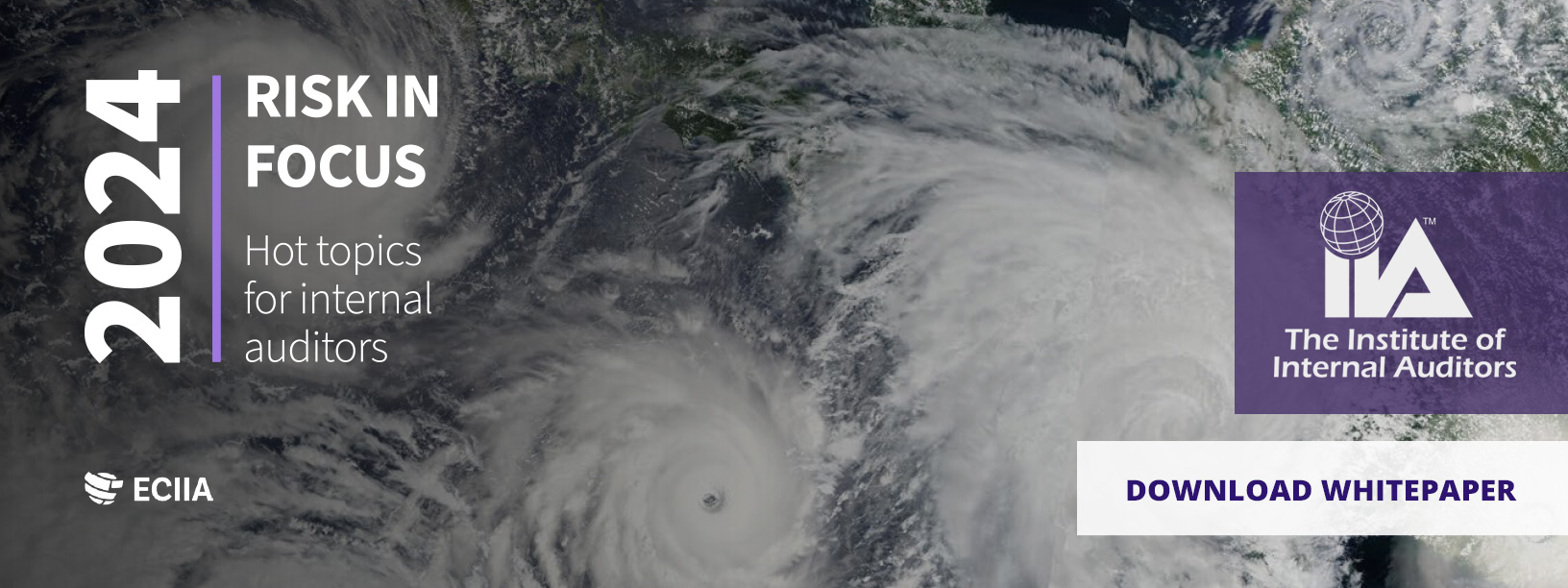En fait, la dette publique, on s’en fout, non ?
Il y a quelques jours, dans une pathétique secousse de fin de règne, le Parlement européen a voté un retour aux critères de déficit budgétaire et d’endettement de Maastricht que peu de pays respectent, tandis que la BCE court après son objectif d’inflation de 2 %. Sur le papier, les choses sont donc claires : l’Europe veut une monnaie forte, désinflatée, soutenue par des États rigoureux, très obéissants, et surtout, surtout, qui déconstruisent le modèle social que tant Von Der Leyen que Lagarde, engluées dans leurs amitiés néolibérales, honnissent. Mais, on le sait, tout le monde aimerait vivre dans le pays appelé « théorie », parce qu’au moins, là-bas, ça a l’air de fonctionner. Or, dans la géopolitique monétaire, tous les pays, à commencer par les États-Unis, s’immergent dans un océan de dettes publiques, à tel point qu’un pays vertueux ressemblerait au fort en thème boutonneux que personne n’aimait. À travers leurs abysses de dettes, les États participent à un affaiblissement de leur monnaie.
Mais, en Europe, la dette publique va inexorablement augmenter avec le coût – non provisionné puisque les systèmes sociaux sont fondés sur la répartition, c’est-à-dire sur la contribution des travailleurs actifs au bénéfice de leurs aînés – du vieillissement de la population. Cette augmentation de la dette publique est le reflet du lien intergénérationnel de l’État social. Bien sûr, il ne faut pas imaginer qu’une dette puisse infiniment augmenter, puisqu’il faut trouver un créancier qui la finance à un taux d’intérêt tolérable. Mais la véritable raison pour laquelle les responsables politiques escamotent l’augmentation de la dette publique, c’est parce que sa réduction entraînerait une contraction des dépenses sociales ou des augmentations d’impôts, auxquels ils se refusent.
Car finalement, la dette publique, c’est la rue contre le capital, raison pour laquelle Karl Marx, qui voyait l’économie dans de puissantes abstractions inaccessibles au grand nombre, la considérait comme un capital fictif, puisque suspendu à un ordre politique qu’il voyait se dissoudre.
Et c’est la raison pour laquelle ce qui va financer cette immense sécurité sociale qui flotte et tourne autour de nos pays, ce sont nos dépôts bancaires et réserves d’assurances qui sont, et seront encore plus dans le futur, canalisés vers le financement des États, à des taux d’intérêt très bas, ce qui entraînera une perte de pouvoir d’achat de l’épargne. Cela s’appelle une répression financière. C’est indolore, anesthésiant, et cela se dilue dans le temps. C’est le capital qui va financer le travail différé Mais comme le capital, c’est du travail passé accumulé, les choses sont lisibles.
Voilà ce qui explique pourquoi la dette publique ne mobilise plus grand monde.
Cela étant, j’enrage encore contre ce fort en thème et sa tête à claques qui me battait en latin. Avec sa raie, et ses lunettes carrées en métal.