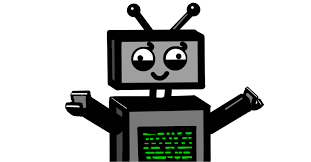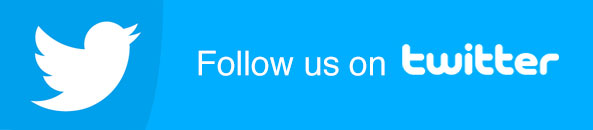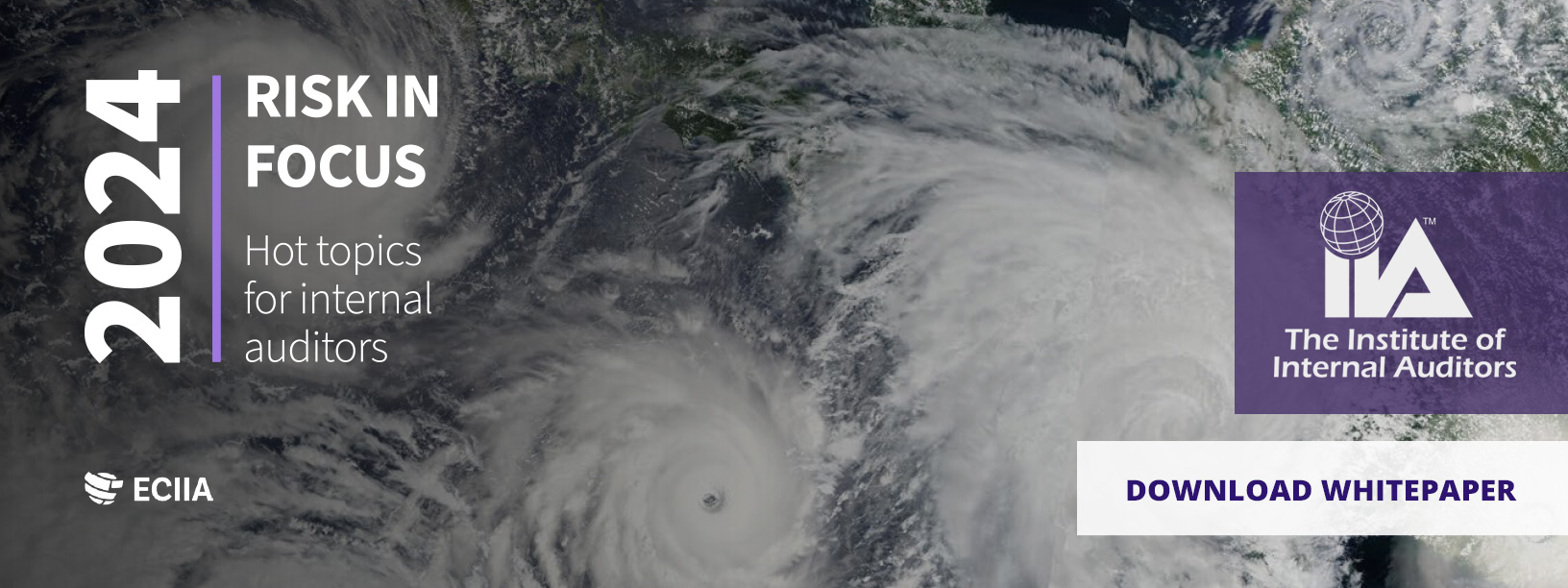Bruno Colmant
Dans la Genèse (3 :19), il est écrit que « C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». Il faut donc travailler pour survivre. Pourtant, cette discipline ancestrale est peut-être caduque. Nos communautés occidentales traversent un bouleversement d’une saisissante amplitude. La mondialisation économique induit un monde multipolaire et complexe. Après les deux premières révolutions industrielles, celle des années 1780 qui a porté sur les sciences et techniques du textile, de la métallurgie et du transport ferroviaire, et celle qui a débuté dans les années 1880 avec l’apparition du moteur à explosion, de l’électricité, de l’automobile et de l’aviation, nous pénétrons dans une troisième révolution économique, celle de la mobilité du capital et de l’information. C’est la révolution digitale.
Cette troisième révolution modifie la typologie du progrès. Le développement des sciences et des techniques se propage désormais au rythme de la transmission de l’information et de la fluidité des capitaux. Cette mondialisation économique altère les espaces-temps. Elle est globale et dissocie la géographie de la formation du savoir des lieux de leur commercialisation.
Trois changements organiques s’alignent dans la morphologie de la sphère marchande
Tout d’abord, l’ère digitale est à l’économie des services ce que fut la désindustrialisation à l’économie manufacturière. Des flux physiques quittent l’économie réelle pour se mécaniser en flux numériques, transportés par Internet. Il s’agit de toutes les applications existantes transportées par les Smartphones, mais aussi les nouveaux modes de commerce (Amazon, eBay) et de paiement (Apple Pay) en passant par la mécanisation des actes administratifs, etc. Concrètement, de nombreuses entreprises de service vont simplifier leurs procédures internes et leurs rapports avec leurs clients au travers d’applications informatiques, de robotisation, de connections qui vont remplacer le rôle qu’entretenaient des travailleurs. La singularité de cette économie digitale est qu’il n’existe pas de superposition géographique entre le travail d’un intermédiaire qui disparaît et un centre informatique qui se situe souvent dans un autre pays. Internet est donc devenu un substitut à l’allocation géographique des facteurs de production en permettant la délocalisation et la désynchronisation des circuits de production. Keynes avait incidemment théorisé ce phénomène en 1930 en invoquant le chômage technologique.
Ensuite, les entreprises qui pilotent cette mondialisation digitale sont des entreprises en situation quasiment monopolistique, à tout le moins dans certaines géographies. Les Etats-Unis entretiennent ces monopoles alors que pendant très longtemps, le capitalisme américain s’est structuré sur leur fragmentation. Il suffit de penser à la téléphonie (AT&T) en 1982. Si la téléphonie fut éclatée, rien de tel ne fut imaginé pour Microsoft et tous les nouveaux opérateurs impliqués dans la digitalisation (Google, etc.).
Enfin, la démocratie se limite aux frontières d’un Etat. Demain, de grandes entreprises, dont les acteurs de la digitalisation, domineront les Etats. Ces entreprises allumeront et éteindront les feux de croissance selon de nombreux critères, sans que l’exercice du pouvoir régalien d’un Etat particulier ne puisse n’être plus qu’un facteur accessoire. Immanquablement, il faudra repenser l’évolution de la sphère marchande selon ces axes.
La taxation des revenus professionnels
Mais un autre problème se pose, à savoir celui de la taxation des revenus professionnels, voire même la notion même de revenu dans un contexte où de nombreuses tâches sont mécanisées. En effet, nos systèmes fiscaux sont fondés sur une économie traditionnelle, c’est-à-dire sur le caractère tangible d’une valeur ajoutée humaine, de nature manufacturière ou intellectuelle. Si les hommes sont remplacés par des processus informatiques ou robotiques, le gain de productivité, qui fonde la rémunération d’un travailleur, et donc la taxation professionnelle de sa valeur ajoutée, se déplace vers l’entreprise qui possède ou opère ces processus. En d’autres termes, la base taxable se déplace latéralement du revenu d’une personne physique vers celui d’une entreprise.
Ceci ne pose pas de problème si ce gisement fiscal ressortit au même pouvoir taxateur. Mais malheureusement, ce n’est pas le cas dans l’économie digitale, puisque la valeur ajoutée des processus se trouve souvent à l’étranger et qu’il est complexe de soumettre des groupes étrangers ou des flux d’informations à une taxation cohérente. On peut bien sûr imaginer une taxation sur la consommation des flux digitaux sous forme de taxe à la consommation, mais ceci supposerait que le transfert d’information, qui n’est qu’un déplacement latéral de flux sans valeur ajoutée systématique, soit correctement mesuré. Ceci relève de l’impossibilité fiscale, et même conceptuelle, car cela reviendrait à taxer, de manière anticipée, la créativité et l’entrepreneuriat qui pourraient découler d’un accès immédiat à des sources d’information. En effet, la révolution de la transmission de l’information induit elle-même un sens de l’histoire instantané, c’est-à-dire un rapport au temps différent. Elle crée des communautés éphémères, transitoires, promptes à stimuler l’échange, la créativité et l’échange commercial. Cette nouvelle relation de l’homme à l’information engendre des associations humaines élastiques, mobiles et donc multiloculaires.
Certaines théories furent formulées. L’économiste suisse Jean de Sismondi (1773-1842) théorisa ce basculement vers la mécanisation en argumentant qu’il profitait au patronat. Selon Sismondi, la machine est un moyen privilégié de l’accumulation de capital parce qu’elle n’a pas besoin de salaire. Il suggéra que tout individu remplacé par une machine reçoive à vie une rente perçue sur la richesse entraînée par cette même mécanisation. En d’autres termes, le propriétaire ou le gestionnaire de processus devrait s’acquitter d’un impôt correspondant à une partie des gains de productivité qu’il soustrait à la sphère marchande « collective ». La théorie de Sismondi fait écho à l’opposition des facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Elle porte sur le partage des gains de productivité, ou du « surprofit » de la théorie marxiste. Malheureusement, elle conduirait à annihiler le rendement du capital lié à l’innovation, sans reconnaitre le caractère schumpétérien des vagues de créativité et de progrès. Les thèses de Sismondi constituent aussi un terreau fertile aux théories d’allocations universelles, bien qu’on puisse s’interroger sur leurs financements si la quantité de travail (et le rendement marginal du travail) baisse au profit d’un rendement marginal croissant du capital. Et, là aussi, on en revient à un déplacement de l’impôt des personnes physiques vers l’impôt des sociétés, en gardant à l’esprit que la digitalisation de l’économie est, pour partie, un bien public. De surcroît, une question porte sur le caractère assurantiel de la sécurité sociale, qui est fondé sur une économie manufacturière, très éloignée du contexte d’économie digitale.
On le voit, la révolution numérique pose de nombreuses questions sociétales. Nous sommes entrés dans une révolution industrielle inouïe, aux frontières de l’intelligence artificielle, des processus infaillibles qui dépassent les fatigues et impuissances des hommes, et des processus qui remplacent les tâches répétitives. Toute l’économie sera pulvérisée par la digitalisation, c’est-à-dire le remplacement de nombreuses activités humaines par des processus. Rien ne résistera à ce monde orwellien. Cette économie sera décentralisée. Les rentes et privilèges professionnels se dilueront. Des industries entières seront mises en péril. Ce seront les entreprises au sein desquels des hommes se limitent à effectuer des taches d’intermédiation ou des métiers qui sont fondés sur la mutualisation (banques, assurances) des paramètres. Cette évaporation des stabilités affectera aussi les systèmes sociaux dont la solidarité, elle-même fondée sur la mutualisation des risques et des situations, sera érodée. Sans être un adepte des théories déclinistes, le basculement sociétal est profond. Les dangers de cette économie algorithmique sont difficiles à circonscrire car le changement de paradigme est sournois. Son fondement, c’est-à-dire le dialogue entre l’Etat et les marchés, est imprécis.
En matière fiscale, la nature de la base taxable se posera si les gains de productivité glissent vers des processus numériques dont les propriétaires peuvent extraire des économies d’échelle importantes. Une taxation des processus ou des flux d’information ou de traitement semble complexe, voire incongrue. A l’intuition, la réponse fiscale à cette évolution sera de faire glisser l’impôt des revenus professionnels vers la taxation de la consommation de biens et de services (y compris des services électroniques mais en écartant certains flux d’information) et de certains revenus du capital au travers d’un impôt des sociétés qui sera modulé selon des articulations encore indiscernables. Le déplacement latéral de l’impôt vers la consommation me semble répondre à la mobilité croissante des hommes, des capitaux et de l’information. De surcroit, l’impôt sur la consommation est à large base et de perception immédiate. Est-ce pour autant une évolution souhaitable sous l’angle de l’équité sociale ? Peut-être pas, mais cette évolution me semble liée à la modification fondamentale du concept fiscal de revenu professionnel, voire de revenu tout court.
Article paru dans La Libre, le 12 décembre 2015.
Economie digitale : on taxe les robots ?
15 décembre 2015