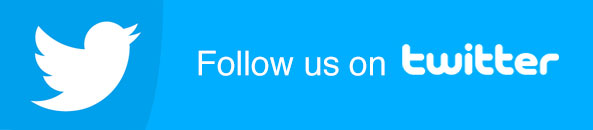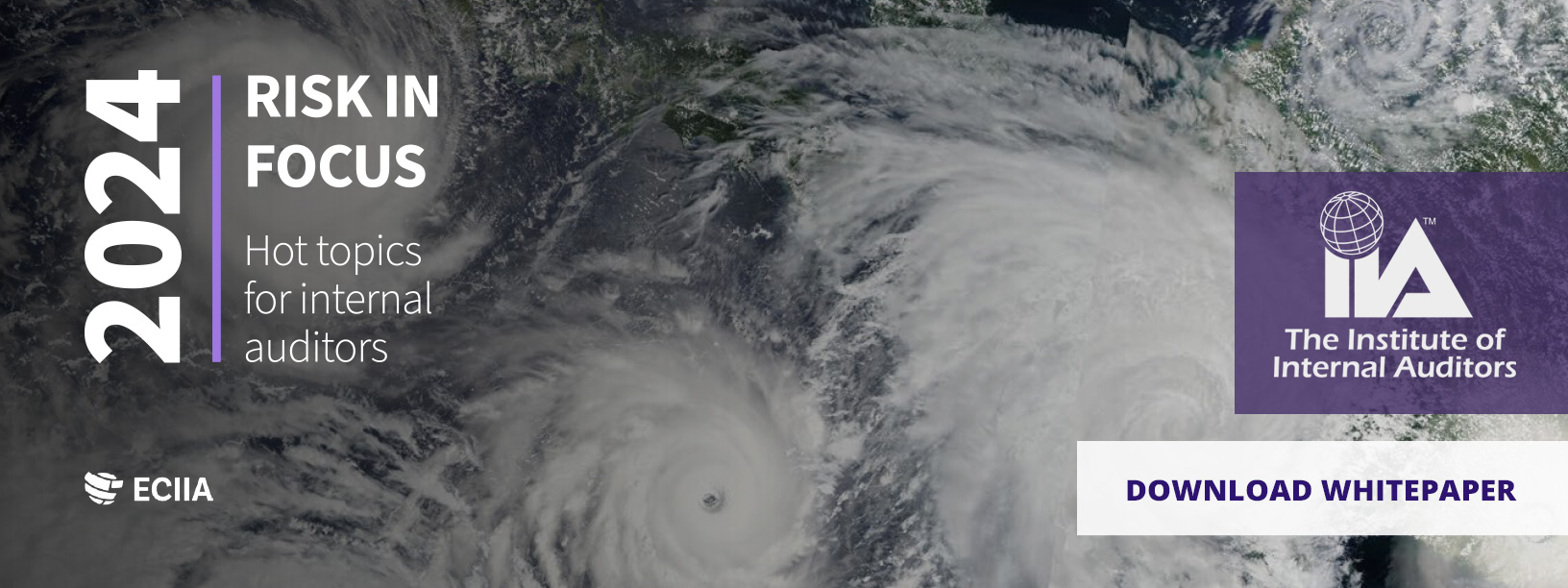Bruno Colmant
Les modifications fiscales répondent très souvent à des motifs budgétaires. C’est incidemment plutôt le cas dans le domaine de l’impôt des personnes physiques que des sociétés, car ce dernier est établi, pour des motifs de cohérence, en interaction avec celui de nos partenaires commerciaux. Je consacre cette courte chronique à une matière peu connue, à savoir l’origine de l’impôt des sociétés.
Cette histoire commence avec la naissance des sociétés, au dix-huitième siècle, et plus précisément par un décret de l’Assemblée Constituante française de mars 1791. Ce dernier stipule qu’il est libre à toute personne de faire négoce ou d’exercer une profession pour autant qu’elle paie une patente. Cette patente était déterminée comme une proportion du loyer ou de la valeur locative de l’habitation au sein de laquelle la profession était exercée. L’impôt des sociétés, comme l’impôt des personnes physiques, était donc basé sur une valeur immobilière, seul élément tangible permettant d’estimer, de manière fiable, les revenus ou le patrimoine d’un contribuable. Il faut rappeler, à cet égard, que sous la période napoléonienne, la taxation des personnes physiques était fondée sur le nombre de fenêtres d’une maison, raison pour laquelle des demeures patriciennes muraient les fenêtres non utilisées.
En 1819, sous le régime hollandais, le système de la patente est complété par une taxe de 2 % sur les capitaux propres des sociétés. Les administrateurs deviennent, eux aussi, taxés sur leur traitement et leurs émoluments. La patente subsista jusqu’en 1913, non sans que des lois de 1823 et 1849 définissent les bénéfices taxables des sociétés comme les « intérêts des capitaux engagés, les dividendes et toutes les autres sommes réparties », ce qui correspond presque mot pour mot à la définition contemporaine.
En 1913, le système de la patente est remplacé par un impôt sur les revenus et les profits « réels » des sociétés par actions. L’impôt taxe tout le bénéfice indépendamment de son affectation. Le taux de l’impôt était alors de… 4 %.
Ce système n’a pas le temps d’être appliqué : la guerre arrive. La première grande réforme fiscale est votée en 1919. On décide alors de ne taxer que les bénéfices distribués, les résultats mis en réserve étant exonérés d’impôt jusqu’à leur distribution ultérieure. En 1919, on décide aussi de taxer les bénéfices des sociétés en considérant qu’une quote-part correspond à un revenu mobilier, c’est-à-dire la rétribution du capital investi. Le législateur de cette époque avait donc inventé les intérêts notionnels avant l’heure, puisque cette technique, imaginée en 1999, avait pour finalité d’écarter de la base imposable la rémunération au taux sans risque des capitaux propres de l’entreprise. On le voit : ces intérêts notionnels ont de nombreux pères putatifs…
Dans les années vingt, on apporte des modifications au système pour corriger la double imposition, ainsi que des amendements de diverses natures, dont l’extension de l’impôt de sociétés aux sociétés de personnes.
Singulièrement, les modifications imposées par l’occupant en 1941 et en 1942 firent progresser l’impôt des sociétés vers sa forme définitive, en soumettant l’ensemble des bénéfices, distribué ou non, à un impôt, tout en conservant une taxe mobilière sur les résultats distribués. Un arrêté de 1942 gomma la différence entre les sociétés de personnes et de capitaux, comme c’est toujours le cas actuellement.
C’est en 1962 que la dernière réforme fiscale fondamentale fut votée. Elle consacra la taxation de la totalité des bénéfices d’une société, mais résolut surtout les problèmes de la double imposition des dividendes. Le problème de la fiscalité des dividendes trouve son origine dans le phénomène de la double imposition économique des bénéfices des sociétés. Puisque les dividendes sont à la jonction de l’entreprise et de ses actionnaires, ceux-ci sont atteints par l’impôt des sociétés avant de subir l’impôt des personnes physiques. En effet, il vient immanquablement un moment où le bénéfice d’une société atteint cette personne physique. On peut donc envisager l’impôt des sociétés comme un prélèvement anticipé de la ponction fiscale qui frappe l’actionnaire. Pour cette raison, la taxation d’un dividende doit respecter une contrainte dominante, à savoir que les bénéfices d’une société doivent s’assimiler aux revenus professionnels d’une personne physique délocalisée dans une société, un peu comme si un indépendant « se mettait » en société.
La taxation des revenus professionnels d’une personne physique doit donc être cohérente avec la fiscalité d’une société, majorée du précompte mobilier qui affecte un dividende. C’est d’ailleurs ce qu’on observe : lorsqu’on additionne le taux de l’impôt de sociétés (34 %) et le taux de précompte mobilier sur les dividendes (27 %), on obtient une taxation globale de l’ordre de 50 %, soit le barème maximal à l’impôt des personnes physiques. La cohérence est donc assurée. Le respect de l’exigence d’équivalence de taxation entre les dividendes et les revenus professionnels avait conduit, en 1962, à une obligation de déclaration et une globalisation des dividendes avec les autres revenus (professionnels, immobiliers et divers). Pourtant, la taxation des dividendes s’est transformée, en 1983, en précompte mobilier libératoire.
Aujourd’hui, l’impôt des sociétés est une matière autonome et cohérente. Cet impôt est malheureusement déconnecté de l’impôt des personnes physiques alors qu’une société est toujours détenue in fine par un être humain. Mais comme on le verra, l’histoire fiscale sera un éternel recommencement…
Un peu d'archéologie fiscale !
25 janvier 2016