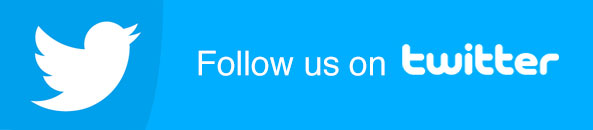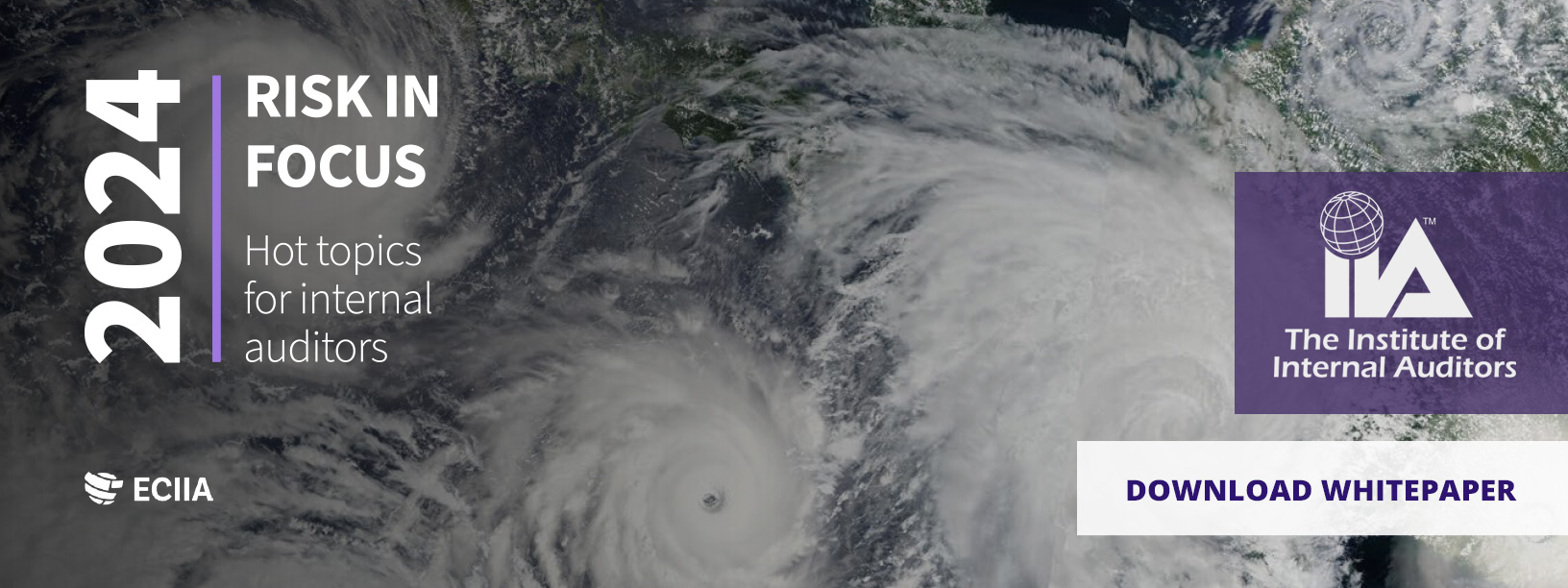Bruno Colmant
L’euro aura été le témoin d’un basculement monétaire sans précédent. Et pourtant, ce n’est que le début d’une révolution financière. En effet, l’euro, monnaie encore adolescente à l’aune de l’histoire numismatique, vient de subir un gigantesque assouplissement quantitatif. Après la crise grecque, qui dévoila le risque du sabordage monétaire, la BCE doit désormais purger l’excédent de dettes publiques par un réescompte de ces dernières. Il s’agit, entre autres, de créer de la monnaie pour éviter que ces dettes publiques en croissance assèchent l’épargne européenne.
Cette approche monétaire aurait été impensable au moment de la création de l’euro, alors qu’Helmut Kohl avait promis que l’abandon du Deutsche Mark se ferait dans une discipline allemande, c’est-à-dire dans le respect d’une monnaie désinflatée et forte. Malheureusement, la réalité a rattrapé les faucons monétaires: les politiques budgétaires ont contribué à contracter l’économie jusqu’à frôler en permanence la déflation que la BCE tente de combattre désormais. A cet égard, la différence avec les Etats-Unis est flagrante: retenant les leçons de 1929, ce pays s’est engagé dans des politiques monétaires extrêmement laxistes qui ont contribué à redresser rapidement cette économie, désormais en plein-emploi.
Le problème de la zone euro est consubstantiel à la formulation de l’euro lui-même. Si tant est qu’un euro regroupant les pays du Nord européen était robuste, il était hasardeux de s’engager dans un projet politique géographiquement trop vaste et aux fondements économiques inexistants. Le défaut originel de l’euro est donc d’avoir découlé d’une décision institutionnelle plutôt que d’une adhésion monétaire naturelle auxquelles des économies convergentes souhaitaient s’associer. Parce que l’espace monétaire est trop large, l’euro ne correspond pas à une zone monétaire optimale, caractérisée par la fluidité des facteurs de production et une spécialisation industrielle ou des services adéquate. Pire, l’euro fut un effet d’aubaine, permettant, dans un premier temps (et toujours encore), à l’Allemagne de ne plus devoir réévaluer le Deutsche Mark tandis que les pays du Sud européen virent leurs taux d’intérêt fondre, comme s’ils empruntaient eux-mêmes en Deutsche Marks.
Les fragilités de conception de la monnaie unique apparaissent aujourd’hui avec une évidence cinglante: la zone monétaire est trop étendue et ses économies dissemblables, les fondements budgétaires et fiscaux sont absents tandis que les dettes publiques, trop importantes, n’ont pas fait l’objet d’une minime mutualisation (à savoir des eurobonds), sauf désormais au travers du rachat d’obligations publiques par la BCE.
Mais, au-delà de ces vices de conception, nous devons assurer, à tout prix, la cohésion de notre monnaie. Un retour en arrière serait catastrophique. Tardivement, la BCE s’est donc engagée dans des mesures monétaires non conventionnelles (qualifiées d’assouplissement quantitatif) qui consistent à acheter des obligations souveraines pour un montant global de 80 milliards d’euros jusqu’en mars 2017. Les statuts de la BCE interdisent de financer directement des Etats, ce qui l’amènerait à en devenir le comptoir d’escompte, mais, en réalité, les obligations souveraines concernées ne transitent que fugacement dans des bilans bancaires avant d’être achetées par la BCE. Parallèlement à ces mesures, la BCE impose un taux d’intérêt négatif (de moins 0,40 %) sur les dépôts bancaires qui lui sont confiés afin de décourager que la monnaie créée n’alimente la thésaurisation au passif de son propre bilan.
Pour comprendre ces mesures, il faut savoir que la monnaie est à la fois un stock et un flux. La BCE fournit un stock de monnaie, tandis que les banques commerciales créent un flux monétaire par la mécanique des dépôts et des crédits. Quand la vélocité de ce flux diminue, la BCE doit la compenser par la création d’un stock de monnaie additionnel. C’est presque une question de vases communicants.
Les mesures prises par la BCE ont permis de fluidifier les circuits monétaires
Pourtant, elles restent temporairement sans effet sur la croissance, et ce pour trois raisons. Tout d’abord, le réescompte d’obligations d’Etat ne crée aucune croissance puisqu’il s’agit de soulager les taux d’intérêt souverain et d’éviter l’asséchement de l’épargne domestique. On ne voit donc pas pourquoi refinancer un Etat qui n’a pas de plans d’investissements productifs conduirait à tracter la croissance. L’excédent de dettes publiques, elles-mêmes en croissance, sera partiellement transformé en offre de monnaie. La création monétaire sera donc alimentée par l’endettement public.
Dans l’hypothèse où l’assouplissement monétaire serait amplifié au-delà de 2018-9, le bilan de la BCE croîtrait au rythme du refinancement des Etats eux-mêmes. Le pire serait évidemment que l’économie européenne ne reprenne pas et que les dettes publiques continuent inexorablement à s’élever en proportion du PIB (ce qui est mon scénario avec l’embrasement du coût des pensions). La BCE serait alors sollicitée de manière inéluctable pour refinancer des Etats, incapable d’en assurer le financement auprès des institutions financières locales ou étrangères. Le risque d’insolvabilité des Etats migrerait alors vers la BCE dont le bilan servirait à consolider une part croissante de l’endettement public. Ce serait évidemment un pas vers une étatisation insidieuse des banques commerciales dont le contrôle prudentiel a d’ailleurs été transféré à la BCE. On remarque d’ailleurs que l’interdépendance de la gestion des États, des banques commerciales et de la BCE s’est accrue dans des proportions qui auraient été inconcevables, il y a quelques années.
Ensuite, la création monétaire reste momentanément coagulée dans les bilans bancaires sans transmission suffisamment rapidement à l’économie réelle sous forme de crédits. En effet, l’économie souffre d’une crise de la demande: la consommation et l’investissement sont insuffisants pour tracter la demande de crédits alors que des facteurs objectifs sont favorables (un euro plus faible, des produits pétroliers moins onéreux, des taux d’intérêt bas, etc.).
Enfin, l’assouplissement quantitatif européen est, par nature, moins efficace que celui qui fut mis en œuvre par la Federal Reserve américaine, car, aux Etats-Unis, le financement des autorités publiques et des entreprises s’effectue directement au travers des marchés financiers, sans passer par les bilans bancaires. La transmission d’un assouplissement à l’économie réelle y est donc plus rapide et efficace.
L’action de la BCE est fondée et légitime. Elle est néanmoins aux antipodes de la conviction allemande qui repose sur le financement de l’endettement public par de l’épargne déjà constituée, et non pas au travers de la création de monnaie. C’est incidemment à ce niveau que se situe le cœur de la crise de la zone euro, à savoir le manque de consensus sur les modalités de la politique monétaire entre les pays dont les devises ont été unifiées. On distingue, au niveau européen, deux courants de pensées. Pour certains, une politique d’inflation minimale devient un objectif de référence, avec son corollaire de politique léthargique, voire déflationniste, caractérisée par un chômage élevé. Pour d’autres, l’inflation ne devrait pas être un obstacle tant qu’elle n’atteint pas des niveaux inquiétants.
Mais, pour les marchés financiers, la véritable question de l’année 2017 résidera dans l’anticipation des mesures de la BCE. En effet, si une conviction de taux d’intérêt bas peut être légitimement justifiée par un contexte économique morose et déflationniste, la nécessité d’affaiblir l’euro sur les marchés financiers et l’impossibilité, pour les Etats européens, de soutenir des taux d’intérêt plus élevés sur leurs dettes publiques, il est incontestable que l’assouplissement quantitatif de la BCE ne sera pas perpétuel (sauf à s’engager dans la voie de l’hyperinflation). A un certain moment, qui reste à définir, le rythme de la croissance monétaire se ralentira. Cette étape coïncidera avec une normalisation légitime de la politique monétaire. La BCE y sera évidemment attentive, mais cela n’escamotera pas une confrontation d’anticipations. Et ceci ramène à une réalité singulière : les marchés relèvent désormais plus de l’économie publique (c’est-à-dire de ma BCE ou de la FED) que d’une économie traditionnelle.
L’autre question concerne l’adhésion de certains pays du Nord à la politique de la BCE. Même si l’Allemagne est le grand bénéficiaire de l’euro grâce à une monnaie affaiblie à l’exportation, la stabilité monétaire relève, dans ce pays, de l’ordre du sacré, voire du divin luthérien. Et la crainte de l’Allemagne, c’est que la BCE ne soit plus la gardienne de la monnaie mais bien la responsable du financement des dettes publiques. Cette situation serait inacceptable pour l’Allemagne qui mettrait son véto à une politique monétaire de plus en plus accommodante. Cette situation signifierait inéluctablement une rupture d’adhésion de certains pays du Nord à la monnaie unique. L’optimisme des marchés repose donc, in fine, sur la cohérence politique qui présidera à la gestion de la BCE. En 2017, l’euro va donc passer un test ultime de crédibilité : celui du consensus politique.
L’auteur, Bruno Colmant, est Head of Macro Research chez Banque Degroof Petercam à Bruxelles.
2017 : l'année de la crédibilité de l'euro
10 janvier 2017