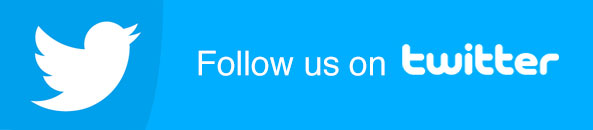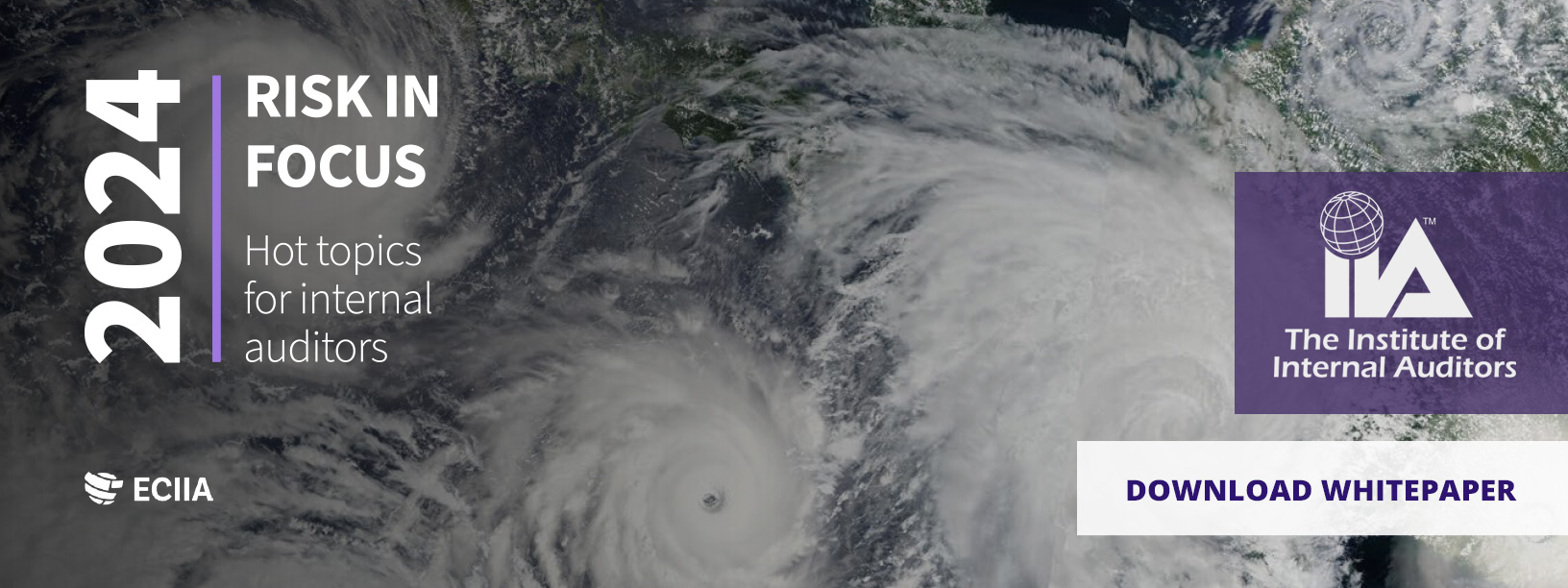Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France
C’est un grand plaisir d’être ici à l’Economic Club de New York. Henry James, le grand romancier américain, new-yorkais de naissance, était également un fin connaisseur de l’Europe. Il a notamment écrit : « C’est un destin complexe que d’être américain, et l’une des responsabilités que cela implique est de lutter contre une valorisation superstitieuse de l’Europe »*[1]. 150 ans plus tard, on peut presque inverser cette citation. C’est un destin complexe que d’être Européen aujourd’hui. Et il nous appartient de reconnaître nos similarités et nos différences avec les États-Unis et d’échapper à la tentation de trop s’appuyer sur nos homologues d’outre-Atlantique pour orienter nos décisions économiques. La politique monétaire n’échappe pas à cette tentation. Il existe souvent une perception selon laquelle la BCE ne peut pas agir, ou n’agira pas, à moins que la Fed ne le fasse d’abord. Soyons clairs d’emblée : comme l’a déclaré Christine Lagarde jeudi dernier, « nous dépendons des données, pas de la Fed » *[2] . Nous prenons nos décisions conformément à notre mandat domestique d’une inflation à 2 % et en évaluant au mieux les données et les perspectives de la zone euro.
Cela étant, nous vivons dans le même monde incertain et risqué – plus encore ces derniers jours – ; les discussions et la confiance que nous partageons de part et d’autre de l’Atlantique constituent notre trésor commun. Nous avons par ailleurs connu des situations parallèles au cours des deux dernières années, principalement sous l’effet d’évolutions communes de l’inflation, elles-mêmes alimentées par des chocs mondiaux. Mais nous avons également des différences importantes, s’agissant notamment des déterminants de l’inflation – liés davantage à la demande aux États Unis, et davantage à des contraintes d’offre en zone euro du fait de notre plus grande dépendance envers l’énergie importée – et du niveau du taux d’intérêt neutre (r*) permettant d’atteindre la stabilité des prix. Nous observons aujourd’hui un processus de désinflation dans les deux zones, mais à des rythmes différents. Dans un discours récent, faisant écho au dernier film français à succès, j’ai essayé d’expliquer « l’anatomie d’une chute » de l’inflation *[3]. Aujourd’hui, je voudrais développer trois dimensions qui sont, selon moi, d’intérêt commun, même si je ne prétends pas commenter la politique monétaire américaine.
Pourquoi les banques centrales ont-elles réussi jusqu’à présent un atterrissage en douceur ?
Premièrement, pourquoi les banques centrales ont-elles réussi jusqu’à présent à mener à bien la désinflation et un atterrissage en douceur face à des chocs d’offre, ce qui est relativement sans précédent ? On considère que les banques centrales réussissent un atterrissage en douceur si elles parviennent à ramener l’inflation à la cible avec un faible coût pour l’emploi – un faible taux de sacrifice dans le jargon économique. Bien entendu, la désinflation observée s’explique en partie par l’inversion des mêmes facteurs d’offre qui avaient initialement provoqué la forte inflation, comme les prix de l’énergie. Et la résilience de l’emploi pourrait être favorisée par des facteurs spécifiques au marché du travail, notamment son amélioration significative en Europe et en France. Mais je souhaite me concentrer sur le rôle de la politique monétaire dans le processus de désinflation. Permettez-moi de souligner un aspect qui est au centre de la politique monétaire moderne, à savoir des anticipations d’inflation bien ancrées.
L’indépendance des banques centrales et le passage au ciblage direct de l’inflation – au lieu du pilotage des agrégats monétaires – constituent un héritage important de la victoire sur l’inflation dans les années 1980. Un engagement crédible à ramener l’inflation à la cible garantit que le public perçoit l’inflation élevée comme temporaire. Au final, cela conduit à ce que la fixation des prix et des salaires reste « ancrée » autour de nos cibles d’inflation, et permet d’éviter les spirales prix-salaires. Une banque centrale disposant d’une fonction de réaction crédible et forte raccourcit significativement la durée des épisodes inflationnistes, et réduit le coût en termes d’activité et d’emploi.
C’est précisément le mécanisme qui a joué lors de la forte hausse de l’inflation en 2022. Dès que le rythme du resserrement monétaire s’est accéléré, mi-2022, la hausse initiale des anticipations d’inflation s’est inversée à la baisse. Ce bon ancrage des anticipations marque une différence décisive avec les années 1970 : la meilleure crédibilité des banques centrales, acquise par leur indépendance et le succès du ciblage d’inflation, a été confortée par leur réaction vigoureuse, et leur a évité d’avoir à porter les taux d’intérêt réels à des niveaux aussi élevés que par le passé.
Mon hôte et co-panéliste, John Williams, a identifié trois critères permettant d’évaluer des anticipations bien ancrées *[4]. Si on les examine pour la zone euro, les deux premiers critères – une absence de sensibilité des anticipations d’inflation à long terme aux nouvelles macroéconomiques et des niveaux conformes à la cible – sont clairement remplis : les anticipations d’inflation à long terme sont restées relativement stables et peu éloignées de la cible de 2 % de la BCE. Le troisième critère d’« incertitude » ou de dispersion nécessite que l’incertitude relative à l’inflation future augmente moins que linéairement avec l’horizon de prévision. Il est plus difficile à évaluer en raison de l’insuffisance des données. Toutefois, les résultats de l’enquête menée par la BCE auprès des prévisionnistes professionnels (EPP) sont plutôt rassurants, brossant un tableau assez comparable à celui des États-Unis. À savoir, la hausse de l’incertitude agrégée entourant les anticipations d’inflation a été plus prononcée sur les horizons à court terme, disons à un ou deux ans, par rapport à l’horizon à plus long terme à 4-5 ans. Et même si la hausse de l’incertitude agrégée a reflété à la fois une accentuation des désaccords entre les prévisionnistes et une augmentation de l’incertitude individuelle, les désaccords entre prévisionnistes ont désormais largement diminué par rapport aux pics de l’année dernière.
Cela étant, il est important de reconnaître deux limites : nous ne comprenons pas encore complètement comment les ménages et les entreprises forment leurs anticipations ni comment cela se traduit dans leurs actions. Et le canal des anticipations ne doit pas laisser penser que la politique monétaire pourrait opérer par des incantations magiques : la crédibilité d’une banque centrale repose sur des actions concrètes et sur leur effet sur le crédit et la demande.
Et cet effet est tangible. Différents modèles développés par la BCE et par la Banque de France quantifient la contribution de la politique monétaire à la désinflation, et estiment que l’inflation aurait été supérieure d’environ 1 à 2 points de pourcentage en 2023 en l’absence de hausses des taux directeurs. L’impact sur 2024 et 2025 pourrait être encore supérieur, en raison des délais de transmission de la politique monétaire.
Allons-nous finalement réussir ? Le défi du dernier kilomètre
Et maintenant ? Allons-nous simplement nous reposer sur nos lauriers et célébrer notre réussite ? Certainement pas. Le succès n’est pas garanti tant que nous n’aurons pas atteint une convergence durable de l’inflation autour de 2 %. Des chocs inattendus et exogènes pourraient survenir en cours de route. Et de nombreux observateurs et responsables politiques ont exprimé la crainte que le dernier kilomètre de la désinflation soit plus ardu. La désinflation doit porter dorénavant sur le « core » et essentiellement les services : elle y serait donc supposément de nature différente, plus difficile, et avec moins de facteurs favorables résultant des effets de base de la désinflation de l’énergie. En termes économiques, la pente de la courbe de Phillips ne serait pas linéaire et désormais moins favorable, entraînant un « ratio de sacrifice » plus élevé.
Mais pour ce qui concerne la zone euro, rien ne vient sérieusement confirmer cette crainte du dernier kilomètre. Certes, l’inflation des services reste plus élevée, à 4%. Mais elle a commencé sa baisse après un pic à 5,6% en juillet 2023 ; historiquement elle était généralement supérieure à la cible d’ensemble de 2%, mais compatible avec celle-ci en raison de la croissance tendancielle plus lente des prix des biens (actuellement à 1,1 %). Nous n’avons en outre pas de signe d’une spirale prix-salaires, alors que les salaires sont particulièrement décisifs pour les prix des services. Au contraire, l’évolution de la rémunération moyenne par tête marque une décélération sensible.
La désinflation des services peut certes être plus lente, mais pas plus ardue ; le dernier kilomètre pourrait être différent dans son rythme, mais pas dans sa nature *[5]. En outre, accepter que ce dernier kilomètre puisse naturellement prendre plus de temps peut être au demeurant une protection contre le risque de manquer la cible d’inflation par le bas, plutôt que de rester excessivement restrictif afin d’accélérer le processus. C’est pourquoi le temps est venu, en zone euro, de réduire la restriction monétaire : à la suite de notre Conseil des gouverneurs de la semaine dernière, nous devrions, sauf chocs majeurs ou surprises, décider une première baisse de taux lors de notre prochaine réunion le 6 juin [date qui coïncide d’ailleurs avec le 80ème anniversaire du D-Day]. Je plaide ensuite pour un gradualisme pragmatique et agile : il devra y avoir d’autres baisses cette année et l’année prochaine ; leur rythme sera guidé par les données, dans le cadre d’une véritable approche réunion par réunion. Nous n’avons pas le même cycle d’activité que les États-Unis, avec une activité nettement moins dynamique : la détente progressive de notre politique monétaire est donc plus évidente, même si elle ne doit pas être complaisante.
Cela étant, nous suivrons attentivement les évolutions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions possibles sur les prix de l’énergie. Si jamais ces conséquences devaient s’avérer durables et se propager – c’est-à-dire si elles affectaient l’inflation sous-jacente – nous disposerions après la première baisse des taux d’une latitude importante pour ajuster, si nécessaire, le rythme et la destination de la trajectoire monétaire : de fait, nous serons de toute façon toujours en territoire restrictif pendant un certain temps.
Où pourrions-nous nous arrêter? Le taux réel neutre (r*) peut-il nous éclairer ?
Enfin, où pourrions-nous nous arrêter? Ici, la profession économique se divise sur l’utilisation d’un concept cher à John Williams, le taux neutre ou taux d’équilibre r* : le taux qui équilibre l’offre et la demande, mais aussi l’épargne et l’investissement. C’est à la fois une variable structurelle essentielle et un repère conjoncturel clé : celui qui distingue l’orientation restrictive et accommodante de la politique monétaire – si l’inflation est trop élevée, les taux d’intérêt doivent monter au dessus de r*, pour freiner la demande – et inversement. Mais le défi est que r* n’est pas observable et doit être estimé : certains demeurent pour cette raison sceptiques quant à la pertinence même du concept. Je suis toutefois un « adepte de r* » et la BCE et la Banque de France se sont risquées à des estimations, à partir d’une suite de modèles semi-structurels.
Ces estimations montrent que la pandémie marque un arrêt dans la tendance baissière de r* observée depuis deux décennies sous l’effet du ralentissement de la croissance et du vieillissement de la population. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’économie en général et pour la politique monétaire en particulier : le risque que les taux d’intérêt atteignent le plancher effectif s’est légèrement atténué.
En zone euro, selon nos estimations, le taux neutre réel serait désormais légèrement positif, entre 0 et 0,5 % ; et donc le taux neutre nominal, avec une inflation à 2 %, pourrait se situer entre 2 % et 2,5 %. Il pourrait être plus élevé d’environ un point aux États-Unis, compte tenu de l’excédent de l’investissement sur l’épargne, et d’une démographie et de gains de productivité plus dynamiques. Cette fourchette de 2 à 2,5 % est une estimation raisonnable de la moyenne des taux directeurs de la BCE sur l’ensemble d’un prochain cycle monétaire. Cet ordre de grandeur ne constitue pas pour autant nécessairement la cible de la phase actuelle de baisse de taux ; il montre simplement que nous avons une marge significative de baisse avant de sortir du territoire restrictif.
Pour résumer, en écho au célèbre roman de Henry James, le temps du « tour de vis » sur les conditions monétaires de la zone euro est révolu ; le moment est venu en Europe de commencer à « desserrer progressivement la vis » et de relâcher la pression. Je vous remercie de votre attention.
*[1]enry James, Lettre écrite en 1872.
*[2]Lagarde (C.), Conférence de presse de la BCE, 11 avril 2024.
*[3]Villeroy de Galhau (F.), « Anatomie d’une chute d’inflation : d’une première phase réussie aux conditions d’un atterrissage maîtrisé », discours, 28 mars 2024.
*[4]Williams (J.), « Effective dialogue and well anchored inflation expectations: essential tools for navigating challenging times », dans Central Banking in the Americas: Lessons from two decades, BRI, novembre 2023.
*[5]Rapach, D., Is-last-mile-more-arduous?, Federal Reserve of Atlanta, janvier 2024.