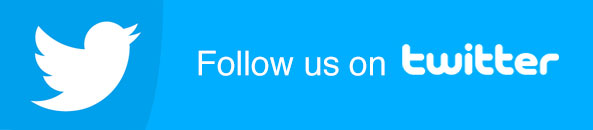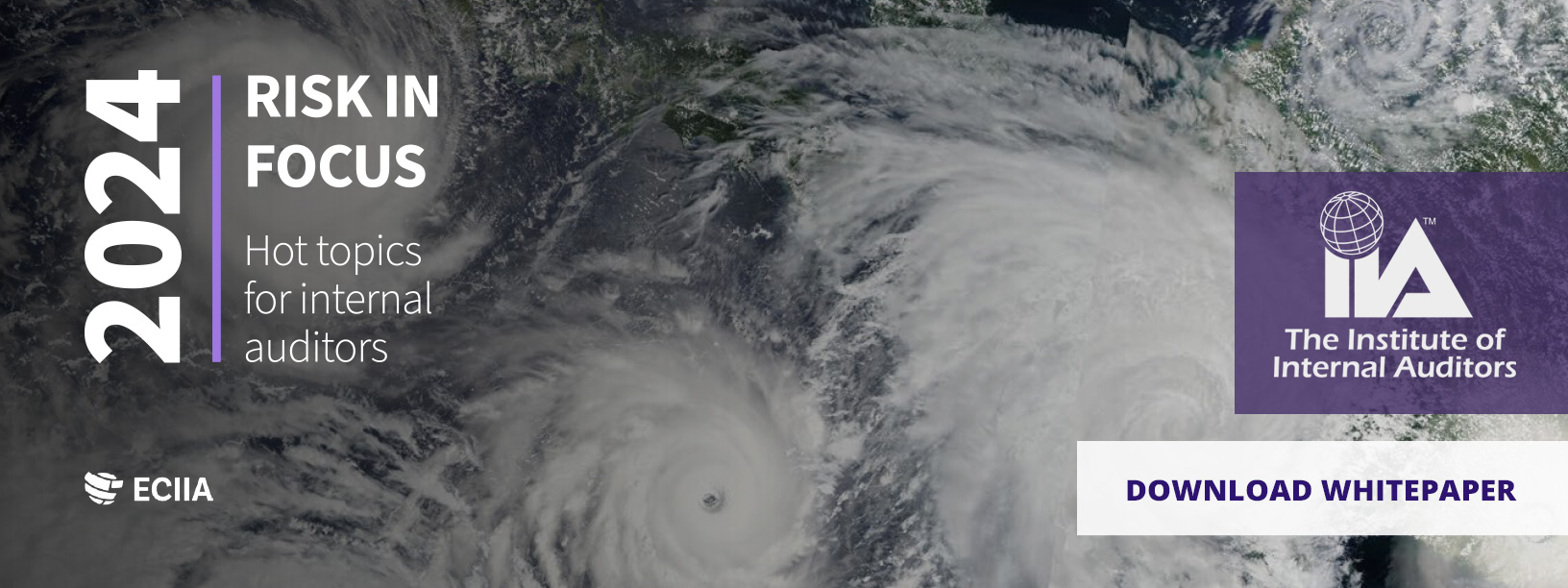Escalader le mur de l’inquiétude
Les tensions géopolitiques s’intensifient. La date prévue pour la première baisse du taux directeur est sans cesse retardée. L’inflation tenace se débat alors qu’elle est entraînée sur une trajectoire descendante. Le taux d’intérêt à long terme cherche à atteindre des niveaux plus bas, mais les banques centrales s’y opposent fermement. La Fed et la BCE se débarrassent rapidement de volumes massifs d’obligations d’État et d’entreprise, ce qui maintient le taux d’intérêt à long terme à un niveau élevé et les prix des obligations à un niveau bas. Mais une vérité boursière bien connue s’est de nouveau imposée à Wall Street : stocks climb the wall of worry (« les actions escaladent le mur de l’inquiétude »). Cette expression renvoie à la forte résilience des marchés boursiers lorsqu’ils sont confrontés à des obstacles et assaillis de revers provisoires. Malgré toute l’agitation et la confusion, l’indice des prix Standard & Poors Composite, largement diversifié, a atteint un nouveau sommet : le 9 février, il a franchi pour la première fois la barre symbolique des 5 000 points. Certes, il a dû partiellement céder le terrain conquis dans les jours qui ont suivi, mais il ne fait guère de doute que cet indice, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, s’établira définitivement au-dessus de 5 000 points dans les mois à venir.
Cependant, cette performance éclatante, avec une hausse de 20 % au cours des 12 derniers mois, ne reflète qu’un pan limité de la réalité économique et masque la situation beaucoup moins favorable d’un grand nombre d’autres entreprises. En effet, les petites et moyennes entreprises ont réalisé des performances beaucoup moins retentissantes. Les indices représentant les petites entreprises ont à peine réussi à sortir du rouge l’année dernière. Mais même au sein du club des 500 plus grandes entreprises de l’indice S&P, les différences sont frappantes. En effet, les hausses boursières sont fortement concentrées autour d’un nombre très limité de valeurs, aux performances brillantes et à la capitalisation boursière extrêmement élevée.
La moitié de l’augmentation totale de la valeur de marché de l’indice S&P au cours des 12 derniers mois est due à la progression de quatre actions seulement, ce qui représente moins d’un pour cent du nombre d’actions de l’indice S&P 500. Il s’agit notamment de NVIDIA, Microsoft, Amazon et Meta Platforms. Si l’on y ajoute quatre autres actions (Apple, Eli Lilly, Broadcom et Alphabet), plus de 70 % de la hausse totale du principal indice boursier américain peut être attribuée à seulement 1,6 % du nombre d’actions. Plus frappant encore : pas moins de 40 % des actions restantes ont apporté une contribution négative, même si les performances du marché boursier de l’année dernière étaient, à première vue, exceptionnelles.
Cela confirme une tendance de longue date : la concentration croissante des bénéfices boursiers dans une poignée d’excellentes entreprises. Une tendance qui s’est encore accélérée ces dernières années : The Winner Takes It All… (« le gagnant rafle tout… ») . Il s’agit d’un nombre limité d’entreprises qui jouent sur les bons thèmes, qui sont moins sensibles aux taux d’intérêt en raison de leurs excédents de trésorerie systématiques et qui résistent mieux aux chocs économiques. L’absence de ce groupe restreint d’entreprises dans un portefeuille d’actions aurait pu, au mieux, conduire à un résultat médiocre. Seul un choix très ciblé dans le secteur de la technologie ou de la santé aurait pu atténuer en partie les dommages résultant de l’absence de l’un de ces géants du marché boursier.
Les niveaux records des marchés d’actions sont nettement en avance sur la réalité économique et financière actuelle. Ils reposent sur le succès d’un nombre particulièrement limité d’entreprises. Cela rend les marchés d’actions très vulnérables aux corrections intermédiaires à la baisse causées par des indicateurs économiques décevants, des réajustements de scénarios de taux d’intérêt trop optimistes ou des développements politiques pernicieux. De telles épreuves de vérité rendront les choses très difficiles pour les marchés financiers au cours des prochains mois, poussant régulièrement au désespoir même les investisseurs les plus chevronnés. Ce sont surtout les prévisions revues à la hausse en matière d’inflation qui assombrissent le climat d’investissement. En effet, les indicateurs d’inflation promettent de maintenir une valeur relativement élevée, certainement jusqu’à la fin du premier semestre. Le chiffre de l’IPC récemment publié[*1] confirme la résistance des prix de détail, malgré une nouvelle baisse des prix de l’énergie et des matières premières.
Il est vrai que cette dernière se traduit (lentement) par un refroidissement des prix des marchandises. Mais, pendant ce temps, l’inflation des services s’emballe, fortement influencée par la hausse des salaires et, surtout, par l’augmentation des coûts de financement. La première s’explique par une réaction tardive aux poussées inflationnistes du passé récent et la seconde est principalement due à la politique téméraire de la Fed en matière de taux d’intérêt. Par conséquent, les entreprises se voient contraintes de répercuter leurs charges financières fortement accrues sur le consommateur final afin de se préserver. La hausse des loyers en est la parfaite illustration : les propriétaires répercutent l’augmentation des coûts de financement, ce qui se traduit par une pression haussière continue sur les loyers. Comme les loyers représentent un tiers de l’indice IPC, il n’est pas surprenant que l’inflation ne soit pas pressée d’atteindre des niveaux plus bas.
Une évolution similaire s’est produite au début des années 1980, lorsque l’inflation est restée à flotter à des niveaux élevés pendant des mois, malgré la chute des prix de l’énergie et des matières premières et une récession économique manifeste. Cette situation s’explique également par la flambée des coûts financiers consécutive à la politique de taux d’intérêt effrénée de la banque centrale américaine. Les récents chiffres de l’IPC ont été pires que prévu, surtout dans le secteur des services. Ces résultats inciteront la banque centrale américaine à maintenir les taux d’intérêt à leur niveau actuel (encore) plus longtemps que prévu. Cette situation correspond d’ailleurs parfaitement au scénario que nous avions envisagé depuis un certain temps. Quoi qu’il en soit, une première baisse des taux n’était pas envisageable avant le début du second semestre. D’une part, parce que les indicateurs d’inflation n’amorceront un mouvement de diminution accéléré qu’à ce moment-là et, d’autre part, parce que les banques centrales ne ralentiront leur politique de resserrement quantitatif (quantitative tightening)[*2] qu’à partir de la mi-2024.
Notre point de départ, même après la publication des prix de détail le 13 février, reste plus ou moins intact. À moins d’une surprise majeure sur le front économique, il n’y a de place que pour trois baisses du taux directeur en 2024, d’un quart de pour cent à chaque fois. Ce n’est pas catastrophique, car nous recherchons surtout pour le moment une croissance plus élevée avec des investissements en actions et nous sommes moins intéressés par des taux d’intérêt plus bas. Entre-temps, les prix des actions aux États-Unis et en Europe rebondiront après chaque plongeon et, moyennant la volatilité nécessaire, s’approcheront à nouveau de leur niveau record antérieur. Au second semestre, la baisse attendue des taux d’intérêt pourrait se poursuivre. Combinée à une reprise économique, elle pourrait déclencher une hausse généralisée des prix des actions.
« Ceteris paribus », ajoutent volontiers les économistes (par prudence). Si tout se déroule comme prévu… Sous la même réserve, les obligations continueront de vaciller au cours du premier semestre, mais là aussi, une reprise généralisée des prix est possible au moment du départ du Tour de France.
[*1] L’indice IPC retrace l’évolution des prix de détail.
[*2] Le resserrement quantitatif fait référence à une politique systématique de vente d’obligations d’État et d’entreprise. Cela permet de maintenir les taux d’intérêt sur les obligations à long terme à un niveau (artificiellement) élevé afin de freiner la croissance économique.