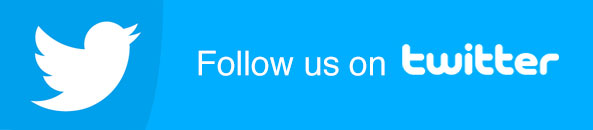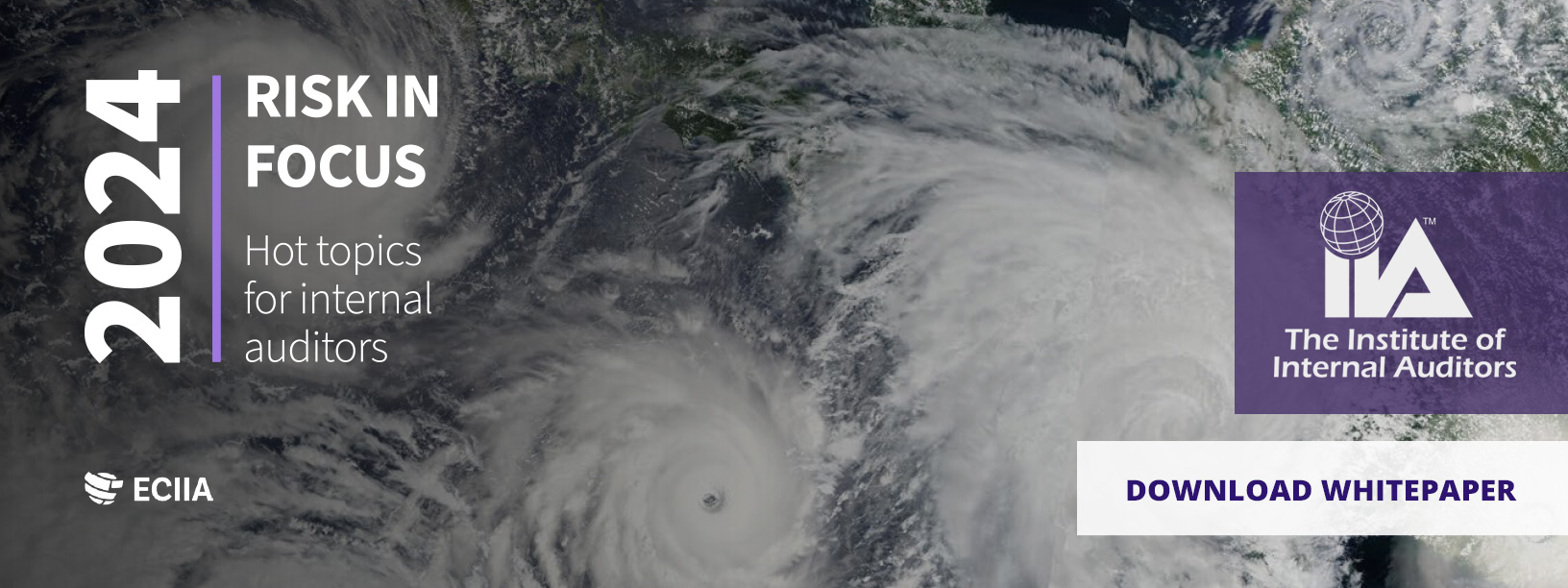Bruno Colmant
Dans son passionnant Verbatim consacré à de Gaulle, Alain Peyrefitte rapporte une scène d’un Conseil des Ministres de la Vème République. A une question du Président concernant l’avancée de négociations commerciales européennes, le Ministre des Affaires Etrangères, Maurice Couve de Murville, lui répondit du ton austère et lapidaire de son affiliation protestante, mais aussi avec une résignation partagée : « Les Belges sont insupportables ».
Souvent, je m’interroge même sur le fait de savoir si, dans un besoin d’instantanéité, nous n’avons pas perdu le sens de l’histoire. En effet, depuis plusieurs années en Europe, et quelques mois en Belgique, le monde occidental est frappé par l’impensable : des crises économiques et monétaires d’amplitude inédite, des Etats vacillants dans un projet européen indécis, des vagues migratoires sans précédent accompagnées de crépitements terroristes conduisant à des attentats, etc. Ces évènements ne sont pas des occurrences isolées. Ils s’inscrivent dans une cinétique de bouleversements du monde dont nous n’avons pas pris toute la mesure car les équilibres géopolitiques se modifient. Ces confusions s’inscrivent elles-mêmes dans de grandes turbulences économiques : la crise de 2008 a laissé de profondes cicatrices, tandis que le vieillissement de la population, combiné aux révolutions de la numérisation, va modifier toute la sphère des comportements économiques. Nous ressentons tous le sentiment diffus de la fin d’un monde révolu.
Or, que se passe-t-il ? Au lieu de prendre le recul de la réflexion et le grand angle du temps, notre pays trouve, de manière introvertie, son occupation dans l’immédiateté. Tout se passe comme si le mouvement se substituait à la pensée stratégique et comme si l’addition des fluences politiques quotidiennes emplissait le vide de l’expression étatique. La nécessité soudaine escamote la création et les critères de la pensée. Par exemple, depuis les attentats, au lieu de consacrer une union nationale et une concentration d’efforts vers l’apaisement, tout n’est qu’expressions de véhémences, déchirures, grèves multiples et autres actes manqués. Que ce soit dans le domaine politique ou syndical, tout le monde veut exister mais sans contribuer à une œuvre commune. C’est frappant dans le domaine institutionnel : alors que la planète se mondialise, nous nous fragmentons en espérant que la crédibilité des entités divisées surmontera l’incrédulité du reste du monde. La Belgique devient d’ailleurs anxiogène car elle est, en permanence, suspendue à l’imminence de réformes constitutionnelles qui rendent ses armatures instables et imprécises. Aucune population ne peut articuler et déployer un projet de prospérité collective lorsque les fondations régaliennes sont instables. De 1970 à 2014, nous avons connu six réformes de l’Etat alors que les Etats-Unis en ont connu seulement 15 depuis le début du 19ème siècle. Dès lors, la gestion de l’Etat belge devient empirique et inductive plutôt que subséquente d’un plan à long terme.
Mais mon questionnement est plus large que ce que m’inspirent des évènements contemporains. Je m’interroge sur cette étrange dérive qui conduit à l’accablement de notre pays. Malgré l’admirable rôle de l’armée, La fierté nationale et le patriotisme se sont évanouis. Le Royaume est inhibé, presque à bout de force. Il est, certes, géré, mais plus dirigé de manière uniforme. L’Etat est devenu administré plutôt que guidé.
Que s’est-il passé pour que notre pays, une des régions les plus prospères au tournant du vingtième siècle, dégringole les marches de la compétitivité et de la dominance économique qu’elle possédait ? On trouvera, bien sûr, des arguments géologiques et des contraintes de taille. Mais cela ne suffit pas : d’autres pays, très petits, du Luxembourg à Singapour en passant par la Corée du Sud, ont réalisé des miracles économiques. Le Japon et l’Allemagne, avec son intransposable Mittelstand, pourtant défaits au terme de la dernière guerre, ont repensé leur projet de société et de prospérité. Est-ce incidemment une question d’empreinte religieuse catholique, opposée à l’esprit collectif des courants réformés ? Peut-être.
Beaucoup de choses se sont passées. La Belgique est sortie éreintée de la Première Guerre Mondiale, avec une devise qui s’est effondrée au cours des années vingt. Les années trente furent un court répit avant le second conflit mondial et le rebond économique signalé par l’opération Gutt et le plan Marshall. Mais, lors de la question royale précédant le retour du Roi, le pays mit le régime au vote. La monarchie en fut désacralisée. Cet événement de 1950, crucial à mes yeux, sépara en pointillé le vingtième siècle institutionnel belge. Ensuite, il y eu quelques années économiquement ensoleillées chevauchant l’exposition universelle avant les grandes grèves et la perte des colonies que les deux chocs pétroliers et l’affaissement manufacturier des années septante ponctuèrent.
Le choc de modèle fut incompréhensible pour les théoriciens habitués à des agrégats conjoncturels stables. Ces observateurs furent confrontés à un phénomène inconnu, et d’ailleurs toujours mal défini : la stagflation, c’est-à-dire une inflation importante conjuguée à un chômage qui devenait structurel. Au niveau politique, aussi, ces années furent indécises. Nos gouvernants n’avaient pas compris la mutation économique. A l’époque, on parlait encore des secteurs nationaux qu’il fallait gérer de manière planifiée et à coups de subsides, au prix de négociations communautaires dont on a vraiment pris l’envergure trente ans plus tard. Le développement technologique avait perturbé le modèle rhénan, fondé sur un cycle de croissance long et une prévisibilité des agrégats économiques.
La Belgique était devenue une économie extractive, à faible valeur ajoutée, tirant profit de sa géographie et de ses colonies. Centrée sur des produits industriels faiblement technologiques, contrairement à l’Allemagne, elle s’engouffra ensuite dans une économie tertiaire peu innovante qui sera bientôt pulvérisée par la numérisation. Le pays entama aussi sa scission avant de se fondre, comme un passager clandestin, dans l’euro. Mais, très rapidement, cette monnaie unique montra ses vices de fabrication et ses artifices, avant que la crise enflamme à nouveau les dettes publiques dans un monde de faible croissance, voire récessionnaire.
Tous, nous sentons que le modèle socio-démocrate qui a caractérisé la paix signée en 1945 et l’ouverture aux pays de l’Est se fissure, tandis que l’Etat-providence fait naufrage dans un endettement public qui est insoutenable. Aujourd’hui, l’Etat est morcelé. Nos centres de décisions se sont, en grande partie, évaporés par un actionnariat qui a quitté le pays sur la pointe des pieds et le dialogue social est exécrable, surtout dans le Sud du Pays.
Quelle est la synthèse de cette évolution ? Je livre la mienne : le pays est inquiet car il n’a plus de père, c’est-à-dire de figure tutélaire. L’enfer, ce n’est pas Jérôme Bosch : c’est la privation du recours paternel. L’autorité chancelle sur des bases fissurées. Depuis 1950, la monarchie est essentiellement symbolique tandis que la chambre de réflexion du pays, à savoir le Sénat, est moribonde. Les gouvernements sont disséminés dans une cosmographie qui apparaît coûteuse et inefficace. Même l’exécutif fédéral, c’est-à-dire la tête de proue du pays, est subordonnée à d’étonnantes contraintes régionales. Cela limite une ambition audacieuse.
Mais il n’y aura pas d’homme providentiel. Les hommes de caractère sont, quant à eux, rares. Plus nombreux sont ceux qui cèdent à la prudence, à l’esquive ou à l’abstention. Mais, sauf à croire que notre pays choisisse de se complaire dans une immense imprécision stratégique, il importe d’exprimer la vision économique de notre futur. Cela exige une clarification, de la lucidité, de l’ambition et surtout un esprit de synthèse exceptionnel. Et, au prix d’une immense intranquillité de tous les citoyens, cette synthèse n’est pas encore formulée.
Ce qui importe désormais, c’est d’avoir un agencement politique qui promeuve la cohésion sociale et l’espérance dans un monde où les bouleversements sont trop nombreux pour pouvoir être compris et intégrés par une population inquiète et désemparée. Quelles que soient leurs formulations, les modèles préconisés par les tribuns de l’extrême ne sont, à mon intuition, que d’éphémères et destructrices expressions médiatiques. La Belgique n’a que faire des vendeurs de grands soirs et autres locutions stériles d’isolationnisme économique. Le pays est exténué par une gestion politique qui soustrait les énergies plutôt qu’elle ne les multiplie. Notre pays a besoin de concentration, de concertation, d’alignement et de promotion de valeurs vertueuses qu’on pourrait englober dans un vocable de patriotisme. Il faut que la critique soit orientée vers une confiance nationale. Plus que la légalité du pouvoir, c’est la légitimité de direction que notre pays revendique. Il faut une renaissance intellectuelle qui suscite l’unité des tendances et le culte de l’intérêt général. C’est à cette seule ascèse morale que ceux qui dirigent ce pays doivent s’astreindre. Il ne faudrait pas, comme de Gaulle l’écrivait en 1932 que, déjà, toute l’espérance du siècle soit dévorée.
Bruno Colmant est Head of Macro Research chez Banque Degroof Petercam.
La Belgique a besoin d 'un bon (re) père
30 octobre 2016