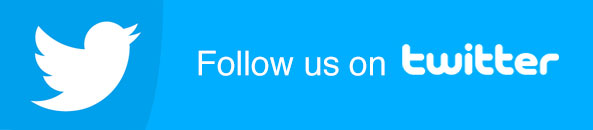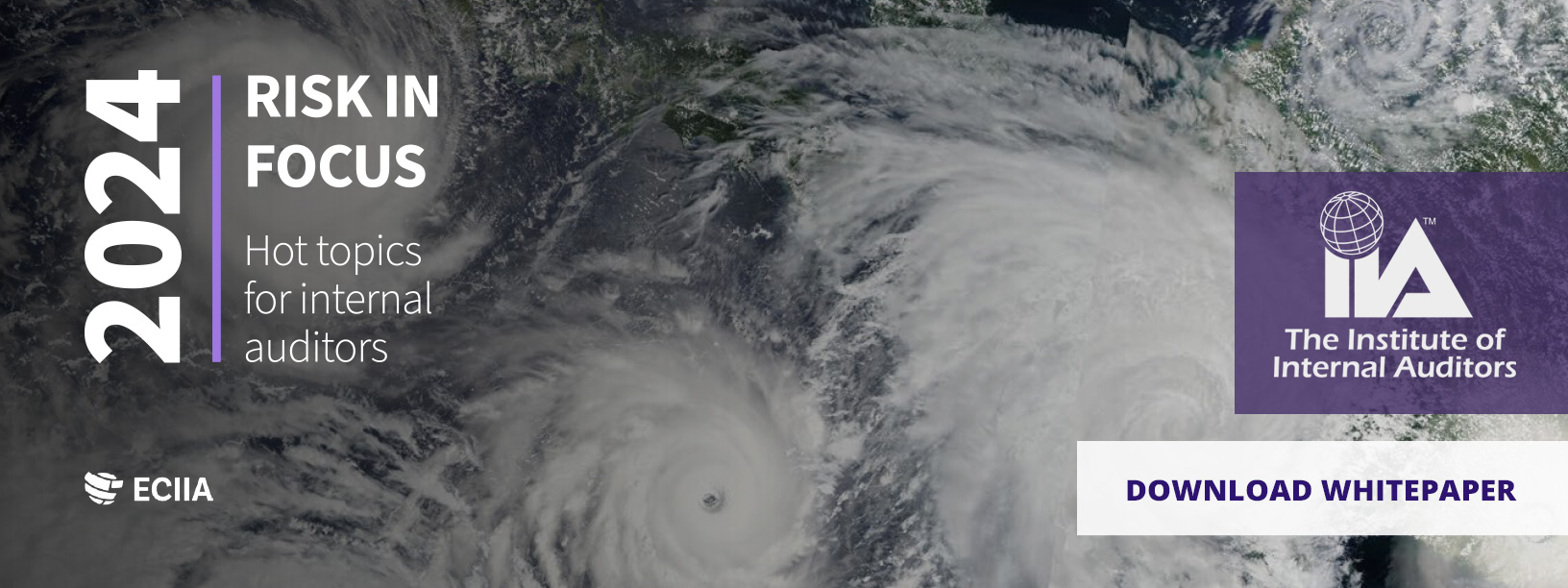Bruno Colmant
Il y a une vingtaine d’années, de nombreuses entreprises industrielles trouvèrent un relais bénéficiaire en délocalisant leurs capacités de production dans les pays de l’Est, à peine sortis de l’ère communiste. Ensuite, le déplacement latéral se déploya dans les pays asiatiques afin de profiter de coûts de main d’œuvre plus modiques. Notre prospérité fut alimentée par le différentiel du coût du travail. Était-ce une démarche visionnaire ou un effet d’aubaine ? C’est difficile à dire : la théorie des avantages comparatifs instruit de déplacer des activités où le coût de production est plus faible.
Quoiqu’il en soit, les entreprises délocalisées ne reviendront jamais, d’autant que la désindustrialisation semble être un attribut des sociétés matures. Malheureusement, si tant est que la théorie des avantages comparatifs de Ricardo s’applique, notre erreur est de ne pas avoir développé suffisamment de compétences domestiques et d’avoir transformé la délocalisation en attentisme.
C’est même pire : nous avons entretenu une économie des services qui, elle aussi, est en train d’être délocalisée. Il s’agit de la digitalisation de l’économie qui induit une désintermédiation. Concrètement, de nombreuses entreprises de service vont simplifier leurs procédures internes et leurs rapports avec leurs clients au travers d’applications informatiques, de robotisation, de connections qui vont remplacer le rôle qu’entretenaient des travailleurs.
Le développement des sciences et des techniques se propage désormais au rythme de la transmission de l’information et de la fluidité des capitaux. Cette mondialisation économique altère les espaces-temps. Elle est globale et dissocie la géographie de la formation du savoir des lieux de leur commercialisation. La synchronisation des temps sociaux devient planétaire. Désormais, la plupart des hommes peuvent, individuellement ou collectivement, être en contact de manière synchrone. La révolution de la transmission de l’information induit elle-même un sens de l’histoire instantané, c’est-à-dire un rapport au temps différent. Elle crée des communautés éphémères, transitoires, promptes à stimuler l’échange, la créativité et l’échange commercial. Cette nouvelle relation de l’homme à l’information engendre des associations humaines élastiques, mobiles et donc multiloculaires.
L’innovation numérique précède une vague de destructions d’emplois
Internet est donc devenu un substitut à l’allocation géographique des facteurs de production en permettant la délocalisation et la désynchronisation des circuits de production. Plusieurs études, menées transversalement dans différents pays européens, indiquent que près de 40% des métiers pourraient être aspirés par l’automatisation des tâches. Bien sûr, d’autres métiers vont apparaître, mais la nature de leur contenu intellectuel ou manuel est indécise. Ce processus est inhérent à la destruction créative des vagues schumpétériennes du progrès humain. Malheureusement, comme Schumpeter l’avait parfaitement prophétisé, la création vient avant la destruction. L’innovation numérique précède donc une vague de destructions d’emplois, d’autant que la technologie est une arme de concurrence.
Un monde technologique exigera une élévation des sciences exactes, mais il permettra aussi une fragmentation des activités humaines, dans une logique décentralisée de déstructuration des monopoles d’exercice (il s’agit de l' »Uber »-isation de nos économies). A cet égard, il serait erroné de croire que la digitalisation va uniquement affecter les tâches manuelles : de plus en plus de métiers intellectuels (dont l’éducation) vont être déstructurés par la digitalisation, puisque la technologie mine les structures antérieures de transfert de l’information. Bien sûr, on pourrait imaginer que la pénétration dans l’économie digitale induise de tels gains de productivité que la quantité de travail nécessaire en soit réduite. Il n’empêche : il y a un risque que cette révolution digitale pulvérise les rapports sociaux, d’autant qu’elle est décentralisée et individualiste, alors que nos modes d’organisation socio-économiques sont planiques, centralisés et collectifs.
Nous avons cru que la mondialisation représentait un mouvement vers l’Est, c’est-à-dire vers les pays au sein desquels nous avons déplacé nos capacités de production. Outre le fait que cette délocalisation aura finalement masqué notre manque d’innovation par un effet temporaire de richesses. C’est désormais l’Ouest qui va absorber nos richesses. En effet, les pays qui contrôlent Internet vont aspirer, par cette désintermédiation digitale, la substance de nos flux économiques. Ces entreprises sont déjà là : elles s’appellent Google, Apple, Amazon, etc. et toutes les entreprises qui vont bénéficier de leurs avancées technologiques. Outre une position quasi monopolistique entretenue par leurs moyens financiers et leur capacité d’innovation, ces entreprises sont caractérisées par un fort contenu capitalistique et une faible création d’emploi. Tout en apportant un progrès incontestable, elles vont aspirer les gains de productivité qui correspondent normalement au taux de croissance de l’économie. Face à ces entreprises, l’économie marchande spontanée n’a que peu de chances.
Pour appréhender le basculement sociétal inouï auquel nous allons être confrontés et, surtout, pour être prêts à le traverser, il faut effectuer un basculement mental géométrique. En effet, il convient abandonner l’image d’un monde vertical et de stocks (comme celui des bâtiments qui abritent nos entreprises) pour pénétrer dans un monde horizontal, c’est-à-dire un monde de flux. Tout se passe comme si l’économie de l’intangible était, par essence, une oscillation latérale. Dans cette logique d’horizontalité, les schémas de commerce vont être fracturés, dans le sens d’une désintermédiation. Cette nouvelle perception du monde demande un effort de versatilité et d’agilité, car nos schémas mentaux, qui sont essentiellement déductifs, doivent désormais apprendre l’induction.
Déjà maintenant, des entreprises dominent les Etats écartelés entre leurs populations de citoyens-consommateurs et ces mêmes entreprises dont les consommateurs-citoyens utilisent les services. La digitalisation risque donc de déstabiliser les agrégats sociaux au travers d’une déliquescence de la classe moyenne et d’un accroissement des inégalités socio-économiques. En particulier, les Etats européens sont écartelés entre la nécessité d’assurer l’ordre social dans un contexte de dettes publiques impayables et des entreprises étrangères géographiquement mobiles qui accaparent une grande partie des gains de productivité. Si cette intuition (simpliste et pessimiste) se confirme, alors la gestion domestique des économies européennes devrait s’étatiser tandis qu’une sphère marchande serait dominée par quelques acteurs internationaux sur lesquels le contrôle étatique deviendrait caduc. On pourrait même imaginer que ces entreprises internationales fassent et défassent les classes moyennes de pays désignés selon leurs intérêts commerciaux et que les Etats en soient réduits à devoir négocier des concordats fiscaux afin de conserver assez d’emplois et d’activités localement.
L’Europe devra revoir son modèle dans deux directions opposées et pourtant conciliables
En résumé, nous n’avons rien compris à la mondialisation car elle est double : il y a une mondialisation géographique (vers l’Est et qui touche la production) et une mondialisation logique (vers l’Ouest qui touche l’économie de service). Nous sommes entrés dans une révolution industrielle inouïe, aux frontières de l’intelligence artificielle, des processus infaillibles qui dépassent les fatigues et impuissances des hommes, et des processus qui remplacent les tâches répétitives. C’est un monde inversé, où les entreprises informatiques dominent les Etats alors que ces derniers sont confinés à assurer l’ordre social et la confrontation avec les promesses qu’ils n’ils n’arriveront pas à tenir. Nous sommes aux confins d’un nouveau monde où l’innovation et l’inventivité prévaudront. C’est un monde très éloigné des années industrielles, plastique et versatile dont le fondement, c’est-à-dire le dialogue entre l’Etat et les marchés, est imprécis. L’Europe devra revoir son modèle dans deux directions opposées et pourtant conciliables : la flexibilisation du travail et la solidarité sociale. En effet, derrière cette vague de la numérisation se dresse l’effritement de la classe moyenne et la déstructuration du secteur tertiaire.
Que faut-il faire ? Je suis de plus en plus convaincu que la solution devrait découler d’une approche plus formelle du déploiement de nos économies, à l’instar des plans quinquennaux que la France avait articulés après la guerre. Il s’agit d’une impulsion qui rapproche les pouvoirs publics et privés et qui conduise à des allocations d’efforts concentrés dans certains domaines. Cette orientation semble d’autant plus pertinente que le socle du progrès repose sur le système éducatif. Je porte donc cette interrogation : le redéploiement économique ne repose-t-il pas plus sur une approche régalienne, à l’instar de ce qu’on constate dans certains domaines aux Etats-Unis, en Allemagne et dans de nombreux pays asiatiques ? Cette intuition découle du fait que les Etats font face à des entreprises mondiales qui captent des rentes économiques. Exiger des « compensations », à l’instar de ce qui fut articulé dans les années septante pour les commandes industrielles étrangères, est bien sûr caduc dans une révolution à faible contenu de travail. La question est donc de savoir d’où viendront les gains de productivité – c’est-à-dire la croissance réelle – de notre économie domestique. Et, à cette question, tout le monde répond par abstention. Peut-être par ce qu’il est trop tard pour donner une réponse intelligible, si ce n’est une vague incantation. C’est à l’Etat de donner un signal fort.
Bruno Colmant est Head of Macro Research Banque Degroof.
La révolution numérique exige de repenser notre organisation sociale
10 octobre 2015