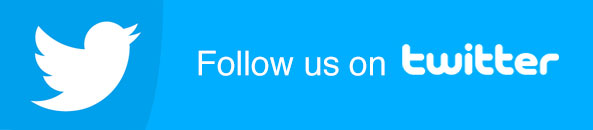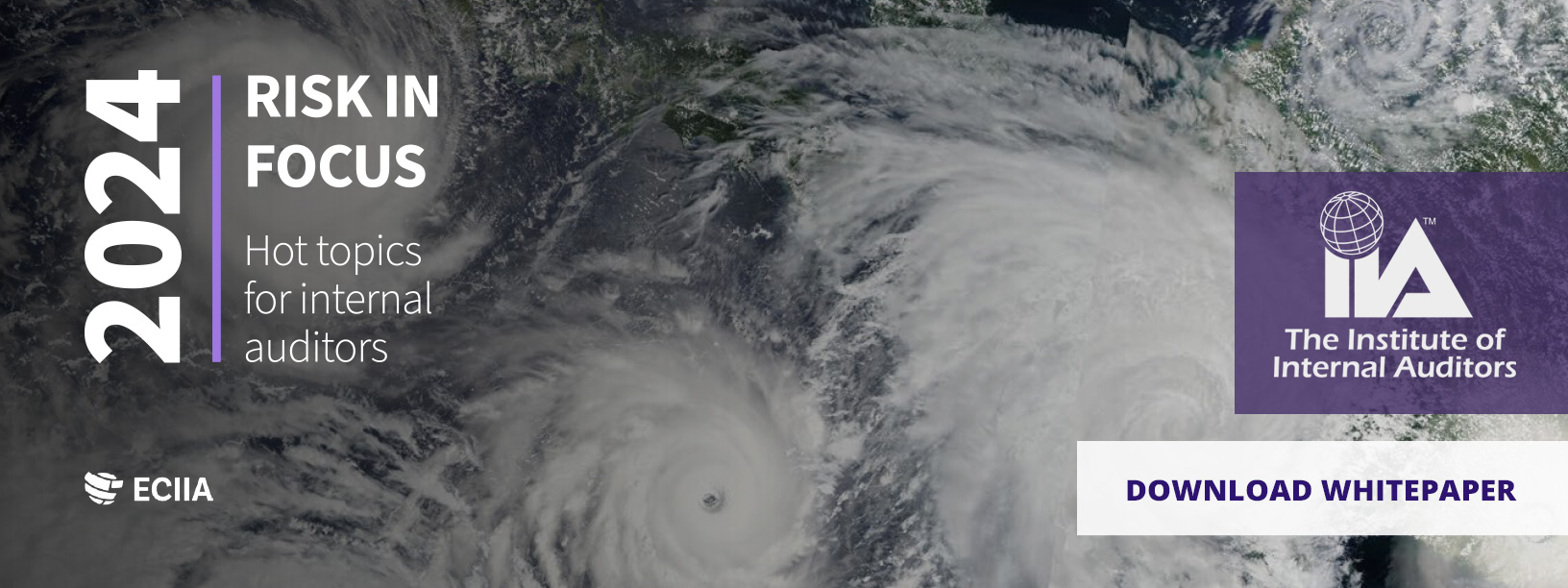Bruno Colmant
Comme les autres instituts d’impression monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) s’est lancée, depuis 2015, dans un gigantesque programme de création monétaire qui dépassera 2.100 milliards d’euros. C’est de la monnaie créée ex nihilo par le fait du Prince. L’objectif de cette mesure non-conventionnelle vise à affaiblir l’euro, à alléger le refinancement des dettes publiques, à stimuler l’octroi de crédits et la demande, mais surtout à susciter une inflation. Pourquoi ? Parce que la hausse de la demande se traduit par une augmentation de la croissance et de l’inflation et inversement. De surcroît, cette dernière facilite l’allocation des ressources et augmente la capacité d’action des politiques monétaires. Or, contre toute attente, la création monétaire de la BCE amène à peine l’inflation au seuil symbolique de 2 % dont cette institution devra d’ailleurs peut-être faire le deuil.
Bien sûr, il existe une inflation du prix des actifs (valeurs boursières, immobilier, etc.), mais elle ne se traduit pas dans les flux de consommation. On constate même une légère reprise d’activité économique sans inflation ! Les économistes (au nombre desquels moi-même) sont désorientés car aucune théorie monétaire ne semble plus s’appliquer. Est-ce parce que ces dernières furent élaborées dans des périodes de croissance démographique alors que le contexte contemporain en est différent ? Traverse-t-on, comme à la fin du 19e siècle, une déflation technologique ? La mondialisation perturbe-t-elle le champ des raisonnements ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, les deux principales théories que constituent le keynésianisme et l’Ecole quantitative, perdent leur pouvoir explicatif. Selon la théorie keynésienne, la monnaie est une marchandise. Sa valeur varie de manière proportionnellement inverse à sa quantité. L’Ecole quantitative suggère, quant à elle, qu’une variation de la quantité de monnaie entraîne, avec éventuel retard, une variation des prix. Si ces théories sont incomplètes, que se passe-t-il pour expliquer un niveau d’inflation global si bas (qui était incidemment la norme avant le 20e siècle) ? Je livre quelques intuitions à la réflexion, sans être capable de les égrener par importance relative.
Le niveau d’inflation ne peut pas s’analyser dans le temps court, mais plutôt dans le cycle long. La décennie maudite des années soixante-dix vit le système monétaire d’après-guerre (les accords de Bretton Woods de 1944 à 1971) être sabordé avant que deux chocs pétroliers et une transition brutale de l’économie manufacturière vers l’économie de services ne conduisent à l’effondrement. A cette époque, les gouvernements occidentaux tentèrent de stimuler l’économie par une politique de déficit budgétaire qui embrasa l’endettement public, déclencha une inflation eschatologique et entraîna des rafales de dévaluations. Au début des années quatre-vingt, les banques centrales agirent de manière synchronisée pour atténuer cette inflation. Il s’ensuivit une période qualifiée de « grande modération » qui conduisit, après la récession de 2009, à une inflation très basse, et sans doute trop basse. Il fallait protéger le pouvoir d’achat du capital.
Le vieillissement de la population est l’arrière-plan commun à tous les scénarios économiques qu’il conditionne. Les années d’après-guerre furent caractérisées par une poussée démographique qualifiée de « baby-boom », conventionnellement constatée entre 1945 et 1963. Ce phénomène trouve désormais sa transposition dans un « papy-boom » qui, sur base d’un départ à la retraite à 65 ans, couvre les années 2010 à 2048, en prenant en compte l’augmentation de l’espérance de vie. Or, une population âgée consomme et investit moins. On constate même une augmentation de la propension à épargner qui obère la consommation. Ce phénomène est intuitivement compréhensible : passé un certain âge, il est complexe de constituer une épargne de précaution. Par ailleurs, les bouleversements technologiques anéantissent le maintien au travail des personnes âgées. De plus, une arithmétique élémentaire démontre l’insoutenabilité des pensions pour lesquelles l’imprévoyance politique a conduit à n’en faire aucune réserve. L’absence de confiance dans l’Etat est de nature déflationniste. Il en résulte un comportement prudent conduisant au maintien d’une épargne prévenante.
Nos économies traversent un choc technologique dont l’envergure est titanesque. Après la banalisation d’Internet et l’infiltration de la digitalisation, c’est l’intelligence artificielle qui va contribuer, dans une proportion croissante, à la création de richesses. Or, cette révolution, destructrice d’emplois, suscite une défiance qui accompagne la constitution d’épargne (et donc la contrainte de la consommation) tout en limitant la rémunération du travail. Cette intuition exige un mot d’explication. Si, auparavant, un humain était rémunéré pour son apport de travail par 100 unités monétaires et pouvait revendiquer que cette rémunération représentait sa force de travail manuel ou intellectuel, l’avènement des machines et autres outils technologiques réduit, au sein de cette rémunération de 100 unités monétaires, l’apport « biologique » de l’humain. Il en résulte une baisse relative de la rémunération du travail. Cela explique, pour partie, pourquoi le plein-emploi dans des pays tels les Etats-Unis ne s’accompagne pas d’une hausse des salaires que certains économistes, dont William Phillips (1914-1975), avaient théorisée. L’explication de l’influence déflationniste de la mécanisation du travail est, en revanche, parfaitement expliquée par Karl Marx (1818-1983). La révolution technologique conduit à éroder l’inflation.
Pour certains économistes, l’économie mondiale serait d’ailleurs entrée dans une période de stagnation séculaire, c’est-à-dire une période prolongée de faible croissance économique. Ce contexte serait alimenté par un accroissement limité de la population et un excès d’épargne sur l’investissement. La globalisation a, quant à elle, permis l’accès à des zones de bas salaires (Chine, Inde, etc.), ce qui a tempéré la globalisation
Le choc conjoncturel de 2008 a constitué un traumatisme profond : l’épargne bancaire fut fragilisée tandis que les années 2009-11 plongèrent de nombreuses économies dans une spirale récessionnaire et déflationniste. La précarisation de l’emploi (travaux atypiques, uberisation, flexibilité accrue mais nécessaire du marché de l’emploi) entraîne une atténuation des revendications salariales dans un marché du travail déstructuré. Cela conditionne négativement l’inflation qui est elle-même étouffée par une concurrence salariale dans la zone euro. La sécurité de l’emploi prime alors sur les augmentations salariales.
Les inégalités sociales croissantes, amplifiées par une décennie de crise, constituent autant de facteurs de désinflation. En effet, l’homogénéité de la classe moyenne d’après-guerre constituait un facteur de confiance collective étançonnée par des systèmes d’Etats-providence. Ces derniers sont devenus impayables. La peur de la chute sociale suscite des comportements prudents d’épargne. Il en résulte une pression négative sur la consommation et sur les investissements de nature désinflationniste.
La dette publique étouffe la croissance et donc l’inflation. C’est une intuition avancée par l’économiste Ricardo (1772-1823) qui supputait que les agents économiques augmentaient leur épargne au détriment de la consommation, donc de l’inflation, quand ils prenaient conscience qu’ils devaient payer l’endettement public par leurs impôts.
Au sein de la zone euro, la gestion de la crise a contribué à aggraver les convergences déflationnistes. L’influence allemande a conduit, contre toute logique, à imposer des politiques d’austérité monétaires et budgétaires. L’euro a conforté la protection du capital au détriment de la promotion de l’emploi. Cette devise est donc une monnaie génétiquement désinflatée et récesionnaire, c’est-à-dire une monnaie qui conserve son pouvoir d’achat au détriment des travailleurs. La réponse à la crise souveraine de 2009-11 fut d’ailleurs révélatrice : la Commission européenne imposa de rigoureux programmes d’austérité à des économies en souffrance, faisant basculer la population jeune dans le chômage. De plus, la création monétaire de la BCE reste momentanément coagulée dans les bilans bancaires sans transmission suffisamment rapide à l’économie réelle sous forme de crédits. En effet, l’économie souffre d’une crise de la demande : la consommation et l’investissement sont insuffisants pour tracter la demande de crédits alors que des facteurs objectifs sont favorables.
Dans certains secteurs, l’économie traverse un phénomène de désendettement qui comprime l’activité économique. Ceci se combine à un piège de la liquidité qui rend la politique monétaire partiellement inopérante.
Enfin, d’autres phénomènes jouent sans doute un rôle dans la désinflation de l’économie. La sphère marchande devient une salle d’enchère universelle au sein de laquelle de grandes plateformes de commerce, tel Amazon, suscitent une transparence des prix qui compresse l’inflation.
En résumé, l’inflation reste basse et le chômage élevé dans le sillage d’un contexte déflationniste, lui-même entretenu par le vieillissement de la population et le choc digital. La politique budgétaire et monétaire européenne a entretenu ces mêmes forces dans une crise de la demande et un marché du travail déstructuré. Il est possible que l’inflation reste basse dans un contexte de stagnation séculaire que certains assimilent à un scénario « à la japonaise ». Le passage du choc générationnel du papy-boom et un retour à une confiance dans le futur permettront peut-être de retrouver la croissance et l’inflation. Mais ce n’est pas tout : il faudra de massifs programmes d’investissements publics et privés dans les domaines de l’énergie, des communications et des défis sociétaux tels le climat et les migrations. La réalité politique nous fait face : sans promotion du travail, nos économies pourraient succomber sous leurs propres maux d’un capital désinflaté. Il s’agit donc d’un débat politique.
L’auteur, Bruno Colmant, est Head of Macro Research chez Banque Degroof Petercam.
L'absence d'inflation en 10 intuitions
12 novembre 2017