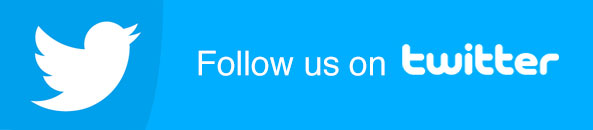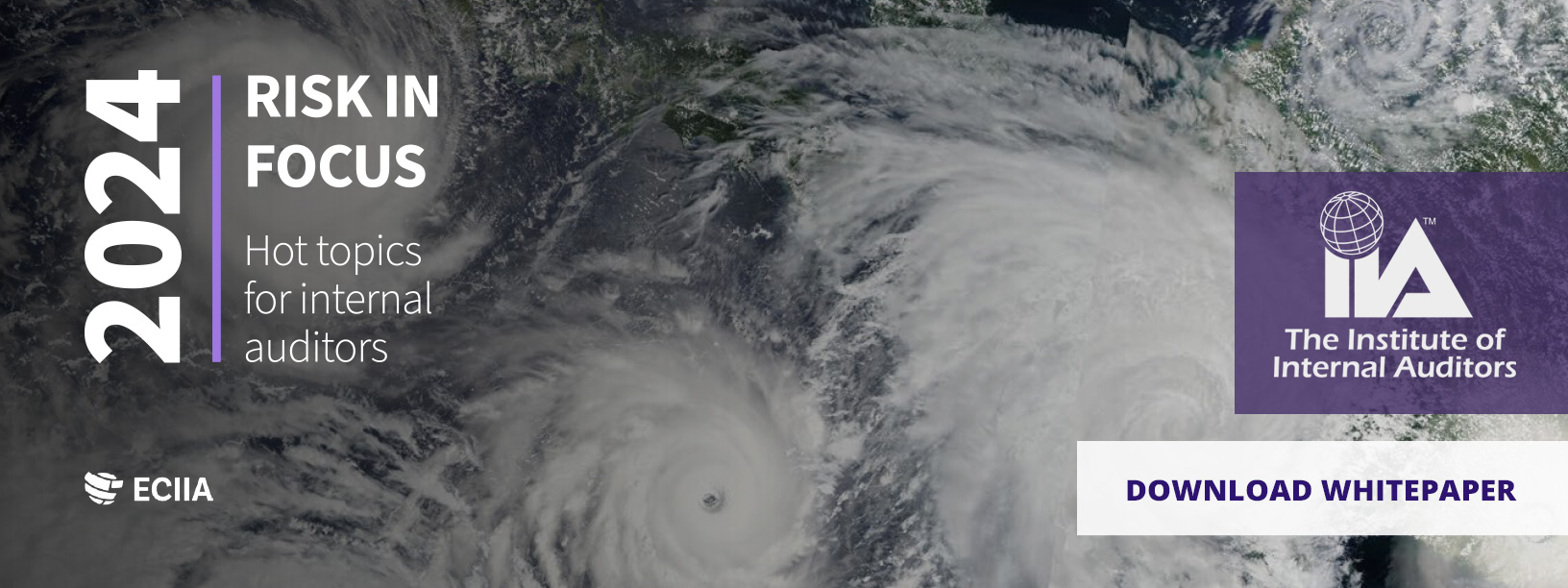Le tax shift et son « effet retour »
Le tax shift n’est pas la grande réforme fiscale que d’aucuns avaient anticipée, mais il n’en avait d’ailleurs pas l’ambition. Ce mouvement giratoire consiste à diminuer le coût salarial global au travers d’une baisse des cotisations sociales et d’une revalorisation des bas salaires nets. Le point d’arrivée de ces mesures est donc une amélioration de la compétitivité. Le financement de ces mesures ressortit, quant à lui, plutôt à un assemblage de mesures diverses qu’à une empreinte décisive.
Il s’agit de prélèvements accrus sur la consommation et, dans une moindre mesure, sur les revenus du capital ou sur les plus-values, encore que l’augmentation du précompte mobilier de 25 % à 27 % ne soit pas négligeable. On remarque incidemment que contrairement à une re-globalisation des revenus, qui était la philosophie fiscale de 1962, c’est désormais un « dual tax system » qui s’impose, c’est-à-dire un système de taxation progressive pour les revenus professionnels et de taxation proportionnel pour les autres revenus (mobiliers, immobiliers et divers) d’une personne physique.
Mais le plus dur reste à faire, à savoir de mettre en œuvre la baisse des charges sociales et l’augmentation des bas salaires. De manière sommaire, il y a deux perspectives.
On pourrait imaginer des mesures linéaires et transversales qui touchent tous les salaires, dont les charges sociales baisseraient de 33 % à 25 % et une augmentation du minimum non imposable qui s’appliquerait à tous les titulaires de revenus professionnels, donc y compris les indépendants. C’est, par exemple, le cas de la revalorisation des déductions forfaitaires pour frais professionnels. Cette orientation s’assimilerait à la « preuve par le futur » et donc à l’espoir d’une reprise par l’offre. Elle susciterait aussi un effet d’aubaine, à savoir le fait que des entreprises en tireraient profit sans devoir mettre en œuvre des actions positives, en termes d’embauches nettes, par exemple.
Cette approche me semble fragile, et je crois d’ailleurs qu’elle ne sera pas retenue par le gouvernement. En effet, cela conduirait aux mêmes dérives que les intérêts notionnels qui réduisirent le coût du capital pour toutes les entreprises et non pas seulement pour celles qui augmentaient leurs capitaux propres ou choisissaient d’accélérer leur politique d’autofinancement au détriment des versements de dividendes. Une augmentation du minimum non imposable (ou une altération de la première tranche d’imposition des revenus professionnels) entrainerait aussi un effet d’aubaine et nuirait même à la progressivité de l’impôt. Elle n’aurait d’ailleurs de fondement qu’au prix d’un rétablissement du dernier barème d’imposition pour les hauts revenus, dont le taux de taxation marginal dépasserait alors 50 %, ce qui est écarté par le gouvernement de Charles Michel.
L’autre approche consisterait à cibler les baisses de charges sociales dans un cadre incitatif, c’est-à-dire selon une modularité qui conditionnerait les avantages fiscaux à certains types de travailleurs. Cette orientation me semblerait plus judicieuse. Elle différencierait l’amélioration de la compétitivité en stimulant l’emploi de certaines classes d’âges ou de métiers. Bien sûr, on argumentera que l’emploi dépend de son coût, mais il est essentiellement la résultante du niveau de demande suscité par la conjoncture économique. Une baisse ciblée des charges sociales permettrait donc de donner des réponses précises au véritable « shift » de l’économie digitale, qui conduit à remplacer des taches humaines d’intermédiation et de production par les processus informatiques ou des machines (robots, etc.). De surcroît, la Belgique est un pays dont le degré d’ouverture en termes d’importation et d’exportation est extrêmement élevé. Si cela est autorisé par les dispositions européennes, on pourrait imaginer de cibler les métiers en concurrence à l’exportation. Ce type de mesure ferait un lointain écho aux mesures Maribel, imaginées en 1981 pour stimuler l’emploi, au moyen d’une réduction des charges patronales pour les entreprises qui avaient eu recours à des travailleurs manuels et spécifiquement tournées vers l’exportation. L’opération Maribel avait certes dû être neutralisée à cause de son caractère discriminant, mais des dispositions fiscales avantageuses existent toujours pour les chercheurs, par exemple.
Une baisse des charges sociales serait aussi avantageusement complétée par des stimulants aux investissements dans les entreprises, dont l’impôt n’est d’ailleurs pas affecté par le tax shift. On pourrait imaginer une réinstauration de la déduction pour investissement, qui avait été escamotée au profit des intérêts notionnels. Il s’agit donc d’une déduction fiscale (immédiate ou différée) lorsqu’un investissement est réalisé. Des variantes pourraient être considérées pour certains investissements (recherche et développement, investissements verts, etc.). On pourrait aussi imaginer des amortissements (fiscalement déductibles) accélérés sur les immobilisations. La déductibilité des amortissements pourrait, quant à elle, porter sur plus de 100 % de la valeur de ces immobilisations, afin de protéger la reconstitution du capital.
Le tax shift n’en est donc qu’au début de son déploiement. Il faudra élaborer un plan de stimulation de l’emploi qui s’inscrive dans le cadre d’un fin ciblage des avantages concurrentiels de notre pays. La Belgique doit inéluctablement ajuster le curseur de ses systèmes de redistribution au regard de son degré de compétitivité mondiale. L’ouverture des marchés est inéluctable, mais sera source d’ajustements et de frictions. Et s’il y a une démarche à envisager, c’est de procéder à l‘analyse des forces et faiblesses stratégiques du pays, comme on le ferait pour une entreprise commerciale. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une analyse SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats). Nous devons, comme le Grand-Duché de Luxembourg, repenser notre modèle économique dans la dépendance des capitaux et des centres de décisions étrangers.
Bruno Colmant