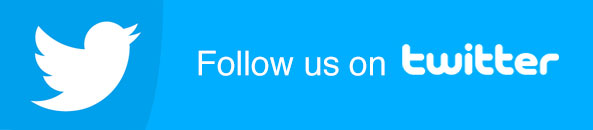Bruno Colmant
Marine Le Pen a répété, à de nombreuses reprises, son souhait de sortir la France de la zone euro. Même si la probabilité d’un tel aboutissement est ténue, les marchés financiers ont immédiatement réagi par une hausse des taux d’intérêt français. En effet, ce n’est pas anodin que la favorite des élections française formule une telle demande…seulement quinze ans après l’introduction des pièces et billets.
La création de l’euro fut une décision essentiellement politique. L’assujettissement d’une population à une monnaie relève toujours des privilèges régaliens mais les vices de fabrication de la monnaie unique apparaissent désormais avec une redoutable cruauté. L’histoire confronte les signataires du Traité de Maastricht à leurs erreurs de jugement : une monnaie ne discipline pas des économies divergentes. Au contraire, la monnaie reflète la force ou la faiblesse d’une économie plutôt qu’elle ne l’induit. C’est ainsi que l’euro a été bâti sur le postulat que les facteurs de production (c’est-à-dire le travail et le capital) allaient s’ajuster, avec vélocité et fluidité, à l’introduction d’un nouvel étalon monétaire. On distingue d’ailleurs la persistance des différences entre un Nord européen caractérisé par une forte industrie, un contrôle des coûts de production et des balances commerciales favorables et un Sud européen qui a un problème de compétitivité et est spécialisé dans des services non exportables. Or l’emprise nationale des États sur le capital et le travail s’est resserrée. L’Europe du Sud est menacée d’un chômage structurel, lié notamment au manque d’intégration des jeunes, à l’absence de stimulations au recyclage, à l’hémorragie de l’emploi industriel, etc. Dans le domaine financier, il y a eu aussi un repli identitaire : les dettes publiques ont re-migré vers leurs pays d’émission au détriment d’un marché intégré des capitaux.
Une réflexion et un droit d’inventaire citoyen s’imposent
Si la monnaie est un fait politique, encore faut-il qu’elle repose sur des fondements économiques robustes. Or, les économies sont toujours asynchrones, c’est-à-dire qu’elles évoluent à des rythmes différents. Si ce n’était pas le cas, il n’existerait d’ailleurs qu’une seule monnaie mondiale. La monnaie ne peut donc s’étendre géographiquement sur un certain périmètre qu’à l’unique condition que les zones couvertes subissent la même pulsation économique. Il existe donc une limite territoriale à une monnaie unique. En d’autres termes, une monnaie ne peut couvrir des pays différents que si des mécanismes permettent de résoudre des chocs asymétriques, c’est-à-dire des événements négatifs qui affecteraient une partie des territoires sans toucher les autres.
On le constate : le travail est resté domestique pour de nombreuses raisons : aptitudes linguistiques, traditions culturelles, contextes éducatifs et socio-économiques différents, etc. On peut même s’avancer à dire que le contexte de taux d’intérêt bas induit par l’euro a conforté les pays dans un immobilisme économique. Du reste, la majorité des migrations internes à la zone euro relève d’un réflexe de survie économique plutôt que d’une immigration choisie. Les exemples portugais et irlandais le démontrent à suffisance : la jeunesse émigrante s’oriente majoritairement hors de la zone euro plutôt que vers les Etats-membre du Nord (Australie pour les Irlandais, anciennes colonies portugaises pour la Lusitanie). Les études indiquent d’ailleurs que la mobilité interrégionale est inférieure à la mobilité émanant de pays tiers à la zone euro.
Mais il n’y a pas que le travail qui est resté domestique : après des années d’euphorie financière et de rapprochements bancaires transfrontaliers, les dettes migrent à nouveau vers leur pays d’origine. C’est très révélateur pour les dettes publiques qui sont re-domestiquées, c’est-à-dire financées par les épargnants situés dans les Etats émetteurs (la dette publique italienne est financée par des banques et des compagnies d’assurances italiennes, etc.). Cette re-domestication des dettes publiques reflète la préoccupation de diminuer le risque systémique de la zone euro. Mais comme le risque ne disparait pas et n’est jamais que déplacé, il est désormais concentré sur certains pays fragiles et caractérisés par une faible épargne. Pourtant, ainsi que nous le suggérons plus loin, cette re-domestication est sans doute le meilleur garde-fou contre une désintégration de l’euro.
Certes, après avoir atteint un niveau de risque extrême en 2011, la crise de l’euro semble s’atténuer : les taux d’intérêt, bien qu’encore fort divergents, s’alignent progressivement et les pays fragiles retrouvent des capacités normalisées d’emprunts publics. Cette évolution favorable résulte d’une action concertée des pouvoirs publics et de la BCE qui, malgré la discipline néfaste que lui impose le cadre monétaire allemand, a agi avec discernement.
Des forces contradictoires
Mais si la monnaie est temporairement stabilisée, les courants profonds qui structurent l’économie européenne sont animés par des forces contradictoires. L’absence de croissance économique, conjuguée aux signes évidents de désinflation, est peut-être annonciatrice de chocs importants. C’est la preuve rétrospective qu’il eut fallu accepter une dose modérée d’inflation au lieu de s’en tenir au mandat littéral de la BCE. Une désinflation persistante serait incidemment une catastrophe car elle ajouterait du chômage à l’absence d’emploi et susciterait des baisses de prix et d’investissements, ainsi qu’une hausse du coût de l’endettement pour les ménages et les Etats.
L’asymétrie entre les pays de la zone euro s’est aussi accentuée. C’est ainsi que les balances commerciales (soit la différence entre les exportations et les importations) des différents Etats-membres montrent des divergences très préoccupantes : la croissance allemande est fondée sur l’exportation. L’Allemagne accumule donc des créances sur d’autres pays de la zone euro, tandis que la France aligne de graves déficits commerciaux dans un contexte de désindustrialisation avancée. La Belgique se situe, quant à elle, dans un état de quasi-équilibre qui bénéficie de la croissance allemande. Plusieurs banques d’affaires ont calculé les pourcentages de dévaluation et de réévaluation des différents Etats-membre de la zone euro s’ils revenaient à leurs devises originelles (Deutsche Mark, franc français, pesetas, etc.). Les chiffres sont ahurissants : le Deutsche mark subirait une réévaluation de 25 % tandis que le franc français serait déprécié de 20 %. On constaterait une divergence de 45 % entre les deux Etats-membre fondateurs de la zone euro alors qu’elle était nulle en 1999 ! Où se situe cette différence ? Elle se traduit actuellement dans des dissonances de désindustrialisation et de chômage. A plus long terme, ces ajustements monétaires se traduiront par des restructurations de dettes dans les pays faibles.
Toutes les erreurs de conception de la monnaie unique apparaissent désormais avec une évidence cinglante : la zone monétaire est trop étendue et ses économies dissemblables, les fondements budgétaires et fiscaux sont absents tandis que les dettes publiques, trop importantes, n’ont pas fait l’objet d’une minime mutualisation, sauf peut-être au travers du rachat d’obligations publiques par la BCE. Les mécanismes de résolution de crises sont obscurs tandis que l’austérité budgétaire imposée aux pays du Sud (et censée remplacer une dévaluation monétaire) a aggravé les chocs asymétriques, ce qui explique que la différence entre les performances économiques du Nord et du Sud s’est creusée en quinze ans.
Comment résoudre ces problèmes : en changeant la trame idéologique de la monnaie qui devra, à un moment, promouvoir le travail plutôt que de désinflater le signe monétaire.
L’auteur, Bruno Colmant est Head of Macro Research chez Banque Degroof Petercam à Bruxelles.
L'euro : un droit d'inventaire
27 février 2017